See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
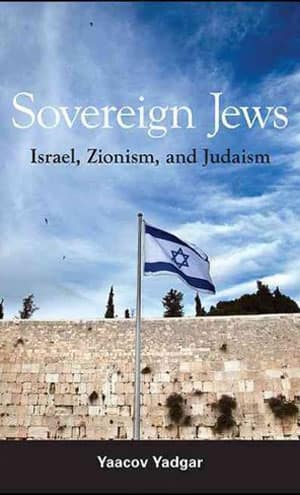
Sovereign Jews. Israel, Zionism and Judaism
Par Yaacov Yadgar - Albany, State University of New York (SUNY) Press, 2017, 279p.
Ce livre, bien écrit et accessible, propose une exploration intellectuelle qui débute avec des questions d’ordre épistémologique, puis passe en revue l’histoire conceptuelle de la religion afin de déboucher sur une analyse de l’idéologie sioniste et, finalement, de la sociopolitique de l’État d’Israël. S’il est clair et cohérent, il manque toutefois d’une conclusion qui aurait pu offrir une synthèse du riche matériel qu’il contient.
L’auteur, politologue et professeur d’études juives à Oxford, traite de la question de la souveraineté juive en rappelant, dès son introduction, que « l’absence de la souveraineté a été la pierre angulaire de la pensée politique juive » (pp. 1-2). Il voit le sionisme politique, fondé vers la fin du XIXe siècle, comme une intervention de la théologie politique chrétienne (p. 72). Le sionisme définit le juif en des termes raciaux propres à l’antisémitisme moderne, qui prend ses racines à la même époque. Le livre analyse en détail la pensée de l’écrivain israélien Avraham B. Yehoshua qui, en s’appuyant sur la définition chrétienne de la religion et en déployant un imaginaire antisémite, considère les juifs des autres pays incomplets et déficients, au même titre que les citoyens palestiniens d’Israël (pp. 192-210). Le lien entre le sionisme et l’antisémitisme apparaît ainsi comme structurel plutôt que simplement conjoncturel.
L’autodéfinition d’Israël comme l’« État-nation des juifs » le force à distinguer entre ses citoyens juifs et non juifs. Pour ce faire, l’État, supposément laïc, recourt au concept essentiellement protestant de « religion juive », tout en assurant le monopole de la version orthodoxe du judaïsme. L’auteur nous rappelle que ce concept porte jusqu’à maintenant l’empreinte de ses origines européennes. Dès lors, il n’est pas étonnant que la participation des juifs africains et asiatiques dans ce projet politique profondément européen fût négligeable.
L’auteur met également en relief la détermination des colons à construire une société à part (hafrada), qui reflète leur distanciation vis-à-vis de la population locale propre à toute expérience coloniale. La perspective de « lévantisation » parmi les indigènes répugne et selon l’un des idéologues du sionisme, presque tous issus de l’Empire russe : « On serait mieux parmi les Polonais et les Russes plutôt que venir ici et s’assimiler parmi les Arabes » (p. 140). Afin de justifier sa prétention d’être l’« État juif », Israël se charge du maintien de l’identité juive des juifs non pratiquants, une situation unique dans l’histoire. Ces citoyens, tout en protestant contre la « coercition religieuse », bénéficient pleinement de leur statut de « juifs d’État » (statist Jew) au sein de l’« État juif » (p. 188).
Les schémas épistémologiques ancrés dans l’expérience européenne s’appliquent difficilement aux réalités non occidentales, tels le judaïsme ou l’islam. L’auteur n’hésite pas à affirmer que le judaïsme en tant que religion apolitique fut « inventé » comme, par ailleurs, fut inventé le « peuple juif » en tant que nation politique dans le sens européen du terme. Le concept de « tradition » est alors énoncé comme plus propice pour l’analyse de la modernité juive.
Yaacov Yadgar propose ainsi un cadre conceptuel novateur et potentiellement fructueux pour l’analyse d’autres expériences politiques non européennes. Il veut libérer la pensée des dichotomies souvent présentées en tant que « partie organique du monde naturel » (p. 27) : Orient versus Occident, modernité versus tradition et, surtout, séculier politique versus religieux apolitique. Le livre mériterait d’être publié en français, car son approche pourrait s’avérer utile en France, où la laïcité conçue en opposition au christianisme est érigée en pilier identitaire universel.
Cet ouvrage s’inscrit dans un courant académique qui explore les différentes facettes de la rupture que constitue le sionisme dans la continuité juive et s’éloigne du narratif officiel israélien, lequel domine de plus en plus le discours politique occidental qui va jusqu’à qualifier d’antisémite toute remise en question, voire toute critique du sionisme et de l’État qui l’incarne.
L’auteur, politologue et professeur d’études juives à Oxford, traite de la question de la souveraineté juive en rappelant, dès son introduction, que « l’absence de la souveraineté a été la pierre angulaire de la pensée politique juive » (pp. 1-2). Il voit le sionisme politique, fondé vers la fin du XIXe siècle, comme une intervention de la théologie politique chrétienne (p. 72). Le sionisme définit le juif en des termes raciaux propres à l’antisémitisme moderne, qui prend ses racines à la même époque. Le livre analyse en détail la pensée de l’écrivain israélien Avraham B. Yehoshua qui, en s’appuyant sur la définition chrétienne de la religion et en déployant un imaginaire antisémite, considère les juifs des autres pays incomplets et déficients, au même titre que les citoyens palestiniens d’Israël (pp. 192-210). Le lien entre le sionisme et l’antisémitisme apparaît ainsi comme structurel plutôt que simplement conjoncturel.
L’autodéfinition d’Israël comme l’« État-nation des juifs » le force à distinguer entre ses citoyens juifs et non juifs. Pour ce faire, l’État, supposément laïc, recourt au concept essentiellement protestant de « religion juive », tout en assurant le monopole de la version orthodoxe du judaïsme. L’auteur nous rappelle que ce concept porte jusqu’à maintenant l’empreinte de ses origines européennes. Dès lors, il n’est pas étonnant que la participation des juifs africains et asiatiques dans ce projet politique profondément européen fût négligeable.
L’auteur met également en relief la détermination des colons à construire une société à part (hafrada), qui reflète leur distanciation vis-à-vis de la population locale propre à toute expérience coloniale. La perspective de « lévantisation » parmi les indigènes répugne et selon l’un des idéologues du sionisme, presque tous issus de l’Empire russe : « On serait mieux parmi les Polonais et les Russes plutôt que venir ici et s’assimiler parmi les Arabes » (p. 140). Afin de justifier sa prétention d’être l’« État juif », Israël se charge du maintien de l’identité juive des juifs non pratiquants, une situation unique dans l’histoire. Ces citoyens, tout en protestant contre la « coercition religieuse », bénéficient pleinement de leur statut de « juifs d’État » (statist Jew) au sein de l’« État juif » (p. 188).
Les schémas épistémologiques ancrés dans l’expérience européenne s’appliquent difficilement aux réalités non occidentales, tels le judaïsme ou l’islam. L’auteur n’hésite pas à affirmer que le judaïsme en tant que religion apolitique fut « inventé » comme, par ailleurs, fut inventé le « peuple juif » en tant que nation politique dans le sens européen du terme. Le concept de « tradition » est alors énoncé comme plus propice pour l’analyse de la modernité juive.
Yaacov Yadgar propose ainsi un cadre conceptuel novateur et potentiellement fructueux pour l’analyse d’autres expériences politiques non européennes. Il veut libérer la pensée des dichotomies souvent présentées en tant que « partie organique du monde naturel » (p. 27) : Orient versus Occident, modernité versus tradition et, surtout, séculier politique versus religieux apolitique. Le livre mériterait d’être publié en français, car son approche pourrait s’avérer utile en France, où la laïcité conçue en opposition au christianisme est érigée en pilier identitaire universel.
Cet ouvrage s’inscrit dans un courant académique qui explore les différentes facettes de la rupture que constitue le sionisme dans la continuité juive et s’éloigne du narratif officiel israélien, lequel domine de plus en plus le discours politique occidental qui va jusqu’à qualifier d’antisémite toute remise en question, voire toute critique du sionisme et de l’État qui l’incarne.