See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
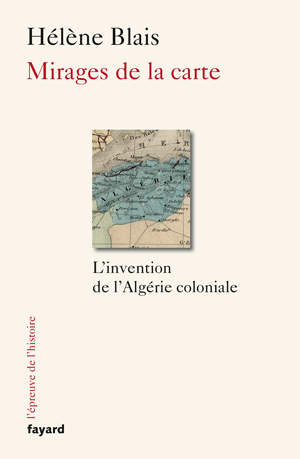
Mirages de la carte. L’invention de l’Algérie coloniale
Hélène Blais - Paris, Fayard, l'épreuve de l'histoire, 2014, 352p.
On connaît la boutade impertinente du géopoliticien français Yves Lacoste : « La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre ». Voici un ouvrage qui inverse cet axiome établi et, loin de le démentir, ne le rend que plus pertinent : la guerre, ça sert également à faire la géographie. C’est ce qui s’est produit en Algérie, dès le premier jour où l’armée française accosta sur la plage de Sidi-Ferruch, à l’Ouest d’Alger, le 5 juin 1830. Hélène Blais se livre ici à un passionnant labeur consistant à suivre pas à pas l’expansion militaire sur le terrain, et au jour le jour l’art et la manière dont le conquérant-explorateur la reproduit, l’interprète et la traduit sur le papier.
Ainsi, l’Algérie sort du mouvement de son histoire propre pour entrer dans celle de la France et dans la géographie tout court. En foulant le sol d’une régence sous suzeraineté ottomane qui a vécu le dos tourné au pays profond et n’a d’yeux que pour la mer, le conquérant français ne dispose que d’une vision parcellaire, alliant récits de voyages, croquis de marins, esquisses d’informateurs plus ou moins fiables, en un mot un viatique peu engageant. D’où la décision d’entrer en possession du pays en le « reconnaissant » – ainsi qu’on le disait à l’époque. Il s’agit alors de le parcourir en tous sens, d’en mesurer l’espace, de jauger son relief, d’en « camper » les habitants, en somme de le cartographier. Et, bien entendu, en nommant ou renommant chaque recoin, le moindre hameau ou tel oued, l’envahisseur se rend maître du lieu en le dotant d’une carte – géographique – d’identité. À cet égard, les pages consacrées au Sahara rappellent fort utilement ce fait trop méconnu que c’est par la volonté coloniale française que les « possessions françaises » d’Afrique du Nord, à savoir la future Algérie, se sont peu à peu étendues vers le sud, jusqu’à la lisière du tropique du Cancer. « Territoires du Sud » au tournant du XXe siècle, ces immenses solitudes désertiques, dont on ne soupçonnait pas encore les richesses enfouies, seront finalement rattachées à l’Algérie. Lors des négociations précédant l’indépendance, la France tenta, sans grande conviction, de faire valoir son droit de propriété sur le Sahara, mais le FLN ne voulut rien entendre. Le Sahara serait donc algérien.
Que serait aujourd’hui l’Algérie si elle n’avait subi la conquête française et si elle n’avait été arpentée par les cartographes-soldats qui ont, à la manière des moines-soldats, agit avec un zèle maniaque du détail, une soif insatiable d’avancer, de découvrir, de couvrir, de répertorier, afin de mieux annexer, dès la IIe République, un pays après l’avoir justement « reconnu » ? Tant il est patent que la greffe française sur le sol algérien reste si prégnante que des noms de lieux arabes francisés par l’occupant et transcrits en lettres latines ignorant les gutturales ont été maintenus tels quels par l’administration algérienne, et ce en dépit d’une inlassable entreprise d’arabisation forcenée. Deux exemples : le village de Staouéli, francisation de Stah El-Wali – « la terrasse du saint » –, situé entre Sidi-Ferruch et Alger, est encore et toujours transcrit de la même manière, y compris en lettres arabes ; et la commune d’Izerraguène – les rivières sinueuses –, dans les Babors, en Petite Kabylie, a vu son nom amputé et simplifié par le français en « Erraguène », puis repris par l’Algérie indépendante, et arabisé phonétiquement en « Erraquen » – l’alphabet arabe ignorant la lettre « g » –, alors que la vox populi appelle toujours l’endroit par son nom originel. Que serait donc l’Algérie sans cet apport français ? C’est la question troublante, fascinante même, qui traverse en filigrane cet ouvrage érudit, et à laquelle le lecteur familier de l’Algérie continuera de penser longtemps après l’avoir refermé.
Ainsi, l’Algérie sort du mouvement de son histoire propre pour entrer dans celle de la France et dans la géographie tout court. En foulant le sol d’une régence sous suzeraineté ottomane qui a vécu le dos tourné au pays profond et n’a d’yeux que pour la mer, le conquérant français ne dispose que d’une vision parcellaire, alliant récits de voyages, croquis de marins, esquisses d’informateurs plus ou moins fiables, en un mot un viatique peu engageant. D’où la décision d’entrer en possession du pays en le « reconnaissant » – ainsi qu’on le disait à l’époque. Il s’agit alors de le parcourir en tous sens, d’en mesurer l’espace, de jauger son relief, d’en « camper » les habitants, en somme de le cartographier. Et, bien entendu, en nommant ou renommant chaque recoin, le moindre hameau ou tel oued, l’envahisseur se rend maître du lieu en le dotant d’une carte – géographique – d’identité. À cet égard, les pages consacrées au Sahara rappellent fort utilement ce fait trop méconnu que c’est par la volonté coloniale française que les « possessions françaises » d’Afrique du Nord, à savoir la future Algérie, se sont peu à peu étendues vers le sud, jusqu’à la lisière du tropique du Cancer. « Territoires du Sud » au tournant du XXe siècle, ces immenses solitudes désertiques, dont on ne soupçonnait pas encore les richesses enfouies, seront finalement rattachées à l’Algérie. Lors des négociations précédant l’indépendance, la France tenta, sans grande conviction, de faire valoir son droit de propriété sur le Sahara, mais le FLN ne voulut rien entendre. Le Sahara serait donc algérien.
Que serait aujourd’hui l’Algérie si elle n’avait subi la conquête française et si elle n’avait été arpentée par les cartographes-soldats qui ont, à la manière des moines-soldats, agit avec un zèle maniaque du détail, une soif insatiable d’avancer, de découvrir, de couvrir, de répertorier, afin de mieux annexer, dès la IIe République, un pays après l’avoir justement « reconnu » ? Tant il est patent que la greffe française sur le sol algérien reste si prégnante que des noms de lieux arabes francisés par l’occupant et transcrits en lettres latines ignorant les gutturales ont été maintenus tels quels par l’administration algérienne, et ce en dépit d’une inlassable entreprise d’arabisation forcenée. Deux exemples : le village de Staouéli, francisation de Stah El-Wali – « la terrasse du saint » –, situé entre Sidi-Ferruch et Alger, est encore et toujours transcrit de la même manière, y compris en lettres arabes ; et la commune d’Izerraguène – les rivières sinueuses –, dans les Babors, en Petite Kabylie, a vu son nom amputé et simplifié par le français en « Erraguène », puis repris par l’Algérie indépendante, et arabisé phonétiquement en « Erraquen » – l’alphabet arabe ignorant la lettre « g » –, alors que la vox populi appelle toujours l’endroit par son nom originel. Que serait donc l’Algérie sans cet apport français ? C’est la question troublante, fascinante même, qui traverse en filigrane cet ouvrage érudit, et à laquelle le lecteur familier de l’Algérie continuera de penser longtemps après l’avoir refermé.