See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
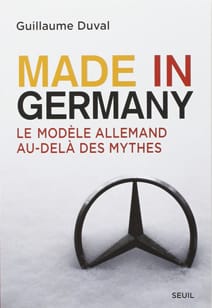
Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes
par Guillaume Duval - Paris, Seuil, 2013, 230 p.
Voilà un ouvrage bienvenu pour expliquer les vraies et fausses raisons du succès allemand – encore faut-il s’entendre sur la notion de succès et déterminer ses bénéficiaires. Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques ayant travaillé pendant plusieurs années en Allemagne, offre une présentation claire et saisissante de la réalité outre-Rhin. Il existe effectivement un modèle allemand, en voie de mutation d’ailleurs, mais ce ne sont pas les sacrifices et les réformes imposés par Gerhard Schröder qui ont permis son triomphe actuel ; c’est la résilience du modèle allemand et des règles imposées à l’Europe a l’avantage de l’Allemagne qui expliquent sa bonne santé.
Selon l’auteur, l’atout de l’Allemagne réside dans son modèle de gouvernance de l’entreprise et de l’industrie, qui donne, via le système de « codétermination », une part du pouvoir aux représentants du personnel. Reflétant une société plus conservatrice mais plus ouverte, l’industrie allemande, faisant la part belle à l’apprentissage et la promotion interne, se caractérise par une plus grande concurrence que le modèle français, encore structuré autour de la collusion entre la haute administration et les grands groupes plus ou moins privatisés.
La société allemande se caractérise aussi par une forte capacité d’auto-organisation, laissant à l’État une place plus modeste. L’ordolibéralisme, qui cadre l’action politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donne bien un rôle central à l’État, mais il consiste à établir des règles précises et à les faire strictement respecter, notamment en matière de concurrence. Cette absence d’interventionnisme ou de rôle distributif se traduit par un moindre taux de prélèvements obligatoires, d’autant plus que la baisse démographique et un taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur plus faible limitent les dépenses publiques d’éducation. La modestie de la politique de défense renforce cette modération fiscale.
L’Allemagne connaissait pourtant des difficultés de croissance à la fin des années 1990, ce qui a donné prétexte à l’équipe de G. Schröder pour lancer un train de réformes inspirées du libéralisme anglo-saxon : baisse des dépenses publiques et des impôts, assouplissement sévère du droit du travail, réforme des retraites, développement de l’emploi précaire, diminution des dépenses d’assurance-maladie, etc. L’auteur montre que, loin d’avoir relancé l’économie allemande, le bilan de G. Schröder a été négatif. Paradoxalement, la politique moins « antisociale » d’Angela
Merkel a aidé l’économie allemande à renouer avec la croissance et l’emploi. Surtout, l’industrie allemande a su bénéficier de la crise et des règles imposées à l’Europe, notamment du niveau de taux de change. Forte de sa position dominante sur quelques spécialités des biens d’équipement et de l’automobile de luxe, elle a su tirer avantage de l’essor des pays émergents. Son rapport compétitivité-coûts ne résulte pas principalement de la baisse des salaires et des prélèvements sociaux, mais plutôt de l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale dans la chaîne de production et du moindre cout de l’immobilier. Car pour le reste, une étude du US Bureau of Labor Statistics notait qu’en 2010, le cout horaire du travail dans le secteur industriel allemand était de 43,80 dollars, contre 40,60 en France (p. 202).
L’auteur présente, en définitive, un tableau objectif, montrant les points forts d’un modèle, qui peuvent utilement servir d’inspiration aux réformistes français. Mais le visage d’un pays en plein déclin démographique, marqué par l’essor des « minijobs » et la persistance de fortes inégalités entre hommes et femmes, et dont les infrastructures se dégradent par manque d’investissement public, laisse un sentiment mitigé.
Selon l’auteur, l’atout de l’Allemagne réside dans son modèle de gouvernance de l’entreprise et de l’industrie, qui donne, via le système de « codétermination », une part du pouvoir aux représentants du personnel. Reflétant une société plus conservatrice mais plus ouverte, l’industrie allemande, faisant la part belle à l’apprentissage et la promotion interne, se caractérise par une plus grande concurrence que le modèle français, encore structuré autour de la collusion entre la haute administration et les grands groupes plus ou moins privatisés.
La société allemande se caractérise aussi par une forte capacité d’auto-organisation, laissant à l’État une place plus modeste. L’ordolibéralisme, qui cadre l’action politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donne bien un rôle central à l’État, mais il consiste à établir des règles précises et à les faire strictement respecter, notamment en matière de concurrence. Cette absence d’interventionnisme ou de rôle distributif se traduit par un moindre taux de prélèvements obligatoires, d’autant plus que la baisse démographique et un taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur plus faible limitent les dépenses publiques d’éducation. La modestie de la politique de défense renforce cette modération fiscale.
L’Allemagne connaissait pourtant des difficultés de croissance à la fin des années 1990, ce qui a donné prétexte à l’équipe de G. Schröder pour lancer un train de réformes inspirées du libéralisme anglo-saxon : baisse des dépenses publiques et des impôts, assouplissement sévère du droit du travail, réforme des retraites, développement de l’emploi précaire, diminution des dépenses d’assurance-maladie, etc. L’auteur montre que, loin d’avoir relancé l’économie allemande, le bilan de G. Schröder a été négatif. Paradoxalement, la politique moins « antisociale » d’Angela
Merkel a aidé l’économie allemande à renouer avec la croissance et l’emploi. Surtout, l’industrie allemande a su bénéficier de la crise et des règles imposées à l’Europe, notamment du niveau de taux de change. Forte de sa position dominante sur quelques spécialités des biens d’équipement et de l’automobile de luxe, elle a su tirer avantage de l’essor des pays émergents. Son rapport compétitivité-coûts ne résulte pas principalement de la baisse des salaires et des prélèvements sociaux, mais plutôt de l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale dans la chaîne de production et du moindre cout de l’immobilier. Car pour le reste, une étude du US Bureau of Labor Statistics notait qu’en 2010, le cout horaire du travail dans le secteur industriel allemand était de 43,80 dollars, contre 40,60 en France (p. 202).
L’auteur présente, en définitive, un tableau objectif, montrant les points forts d’un modèle, qui peuvent utilement servir d’inspiration aux réformistes français. Mais le visage d’un pays en plein déclin démographique, marqué par l’essor des « minijobs » et la persistance de fortes inégalités entre hommes et femmes, et dont les infrastructures se dégradent par manque d’investissement public, laisse un sentiment mitigé.