See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
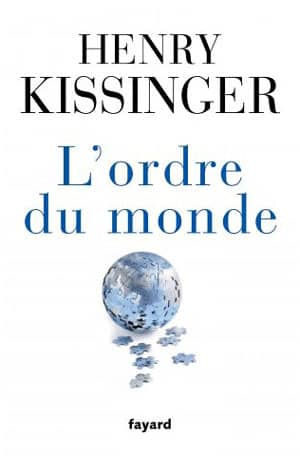
L’ordre du monde
Par Henry Kissinger - Paris, Fayard, 2016, 400p.
On repose le dernier livre d’Henry Kissinger avec deux sentiments contradictoires : l’admiration respectueuse et la gêne persistante. D’un côté, cette brillante fresque de trois siècles et demi d’histoire diplomatique et les analyses visionnaires de l’actualité internationale qui la prolongent ne peuvent que susciter l’admiration. À quatre-vingt-dix ans passés, Henry Kissinger est un monstre sacré des relations internationales : il en fut l’un des acteurs les plus influents aux temps des administrations Nixon et Ford et en reste l’un des commentateurs les plus autorisés. Son livre, typiquement anglo-saxon, est sans équivalent dans l’édition française : il s’agit ni plus ni moins de l’histoire du monde. En ouvrant L’ordre du monde, on se sent d’abord bien modeste face à tant d’érudition, puis un peu plus intelligent en le refermant.
À travers le temps et l’espace, H. Kissinger raconte l’ordre mondial, produit toujours fragile de la combinaison de la force et de la légitimité, au prisme d’une doctrine : la théorie réaliste des relations internationales, dont il est l’un des pères fondateurs (Lire Dario Battistella, « L’ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d’une notion réaliste », La Revue internationale et stratégique, n° 54, été 2004). Ses principes en sont simples : l’histoire des relations internationales est celle des États qui la composent et qui s’opposent au nom de la défense de leurs intérêts égoïstes. Ils ont été posés en 1648 par les traités de Westphalie, qui mirent fin à la guerre de Trente Ans. Ils furent réaffirmés à Vienne en 1815, au lendemain de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Le vingtième siècle les a trahis à deux reprises : en 1919 à Versailles en excluant l’Allemagne de la table de négociation, en 1945 à San Francisco en aspirant à créer une communauté internationale fondée sur des valeurs partagées.
D’inspiration européenne, ces principes westphaliens ont essaimé à travers la planète : dans le monde musulman où l’Islam aspirait à étendre le califat à la terre entière, en Asie où la Chine s’est longtemps perçue comme le « centre du monde » appelé à gouverner « tout ce qui est sous le Ciel ». Par une paradoxale pirouette de l’Histoire, l’ordre westphalien a abandonné les terres qui l’ont vu naître pour trouver une nouvelle vitalité dans des régions qui lui étaient étrangères : l’Europe, bercée par le rêve d’une construction fédérale qui a toujours inspiré et inspire encore à Henry Kissinger le plus grand scepticisme, est devenue post-westphalienne alors que l’Asie et, derrière l’image fallacieuse que donne la croyance en une même foi, le Moyen-Orient, sont devenus des espaces westphaliens où des États s’affrontent au nom de leurs intérêts nationaux.
De l’autre côté, le respect que suscite une si brillante analyse n’empêche pas une gêne persistante. Vingt ans après Diplomacy (1994), son œuvre maîtresse, il livre une analyse qui repose encore et toujours sur les mêmes paradigmes. Témoignage d’une admirable cohérence dans son œuvre ou incapacité à tenir compte de l’évolution du monde ? Henry Kissinger reste fidèle aux principes qui structurent sa pensée depuis sa thèse consacrée, à Harvard en 1954, à la paix de Vienne. Pour lui, seuls les États et leurs intérêts égoïstes importent. H. Kissinger reste aveugle au rôle grandissant des acteurs non étatiques – et aux réflexions de ceux qui, de James Rosenau à Stephen Krasner en passant par Richard Rosecrance ou Susan Strange, n’ont cessé de prophétiser l’avènement d’un monde postnational. Sans doute sensible à cette critique, H. Kissinger consacre l’ultime chapitre de son dernier livre aux questions technologiques. Mais il y est surtout question de l’arme nucléaire – analysée en des termes identiques depuis cinquante ans. Si Internet y est également évoqué, c’est enfin plus pour son impact sur notre vie quotidienne que son influence sur la conduite des relations internationales.
À travers le temps et l’espace, H. Kissinger raconte l’ordre mondial, produit toujours fragile de la combinaison de la force et de la légitimité, au prisme d’une doctrine : la théorie réaliste des relations internationales, dont il est l’un des pères fondateurs (Lire Dario Battistella, « L’ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d’une notion réaliste », La Revue internationale et stratégique, n° 54, été 2004). Ses principes en sont simples : l’histoire des relations internationales est celle des États qui la composent et qui s’opposent au nom de la défense de leurs intérêts égoïstes. Ils ont été posés en 1648 par les traités de Westphalie, qui mirent fin à la guerre de Trente Ans. Ils furent réaffirmés à Vienne en 1815, au lendemain de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Le vingtième siècle les a trahis à deux reprises : en 1919 à Versailles en excluant l’Allemagne de la table de négociation, en 1945 à San Francisco en aspirant à créer une communauté internationale fondée sur des valeurs partagées.
D’inspiration européenne, ces principes westphaliens ont essaimé à travers la planète : dans le monde musulman où l’Islam aspirait à étendre le califat à la terre entière, en Asie où la Chine s’est longtemps perçue comme le « centre du monde » appelé à gouverner « tout ce qui est sous le Ciel ». Par une paradoxale pirouette de l’Histoire, l’ordre westphalien a abandonné les terres qui l’ont vu naître pour trouver une nouvelle vitalité dans des régions qui lui étaient étrangères : l’Europe, bercée par le rêve d’une construction fédérale qui a toujours inspiré et inspire encore à Henry Kissinger le plus grand scepticisme, est devenue post-westphalienne alors que l’Asie et, derrière l’image fallacieuse que donne la croyance en une même foi, le Moyen-Orient, sont devenus des espaces westphaliens où des États s’affrontent au nom de leurs intérêts nationaux.
De l’autre côté, le respect que suscite une si brillante analyse n’empêche pas une gêne persistante. Vingt ans après Diplomacy (1994), son œuvre maîtresse, il livre une analyse qui repose encore et toujours sur les mêmes paradigmes. Témoignage d’une admirable cohérence dans son œuvre ou incapacité à tenir compte de l’évolution du monde ? Henry Kissinger reste fidèle aux principes qui structurent sa pensée depuis sa thèse consacrée, à Harvard en 1954, à la paix de Vienne. Pour lui, seuls les États et leurs intérêts égoïstes importent. H. Kissinger reste aveugle au rôle grandissant des acteurs non étatiques – et aux réflexions de ceux qui, de James Rosenau à Stephen Krasner en passant par Richard Rosecrance ou Susan Strange, n’ont cessé de prophétiser l’avènement d’un monde postnational. Sans doute sensible à cette critique, H. Kissinger consacre l’ultime chapitre de son dernier livre aux questions technologiques. Mais il y est surtout question de l’arme nucléaire – analysée en des termes identiques depuis cinquante ans. Si Internet y est également évoqué, c’est enfin plus pour son impact sur notre vie quotidienne que son influence sur la conduite des relations internationales.