See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
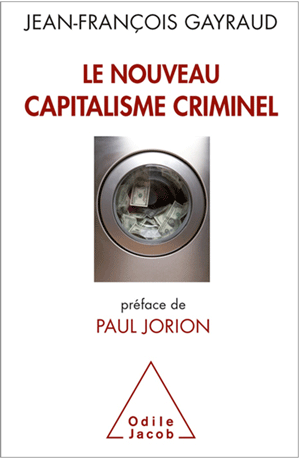
Le nouveau capitalisme criminel
par Jean-François Gayraud - Paris, Odile Jacob, 2014, 368p.
Adepte de l’analyse géopolitique du crime organisé et des systèmes financiers, le haut fonctionnaire de police Jean-François Gayraud consacre son nouvel ouvrage à l’étude de la nature criminogène du capitalisme moderne. La thèse majeure étayée au long de ce livre est ainsi que le crime serait, quelque part, inhérent au capitalisme. Les lacunes dans la régulation, les incitations aux dérives, les multiples exemples de fraude à grande échelle dépassent l’idée que le système engendre la prédation : par moments, la prédation fait système.
J.-F. Gayraud adopte une lecture criminologique des systèmes politico-économiques contemporains, à rebours des sciences sociales, qui ont toujours renvoyé le crime à la périphérie du système. Selon l’auteur, l’imprégnation criminelle des systèmes économiques est telle qu’elle en vient à provoquer directement les crises économiques ou financières, comme au Japon ou en Albanie dans les années 1990, ou lors de la crise américaine de 2008. Les « narcobanques » américaines, qui ventilent l’argent des cartels mexicains, ou les banques du Golfe, qui financent le terrorisme, sont autant de symptômes d’un capitalisme malade, gangréné par une tumeur criminogène. Le livre détaille de nombreux exemples de dérives, pas toujours très récents, mais qui viennent alimenter la théorie de l’auteur. Un cas notoire est celui de la banque pakistanaise BCCI, qui fit faillite de façon spectaculaire en 1991 après avoir soutenu le crime et le terrorisme internationaux, tout en s’implantant dans la finance occidentale.
J.-F. Gayraud présente ensuite un nouveau mécanisme financier, qui illustre concrètement le potentiel de prédation permis par le système capitaliste. Le trading à haute fréquence, pratique encore méconnue en France mais déjà pratiquée par de nombreuses institutions financières, serait en effet la dernière dérive du capitalisme financier. Cette méthode, qui consiste à automatiser les transactions boursières afin d’en réaliser des milliers à la seconde, complexifie encore davantage le système financier contemporain. De plus en plus volatile et propice aux fraudes internes, la finance moderne exacerbe les risques de crises soudaines et imprévues. Plus grave encore, le fait que les dirigeants politiques ne sont plus à même de comprendre les dernières évolutions technologiques de la finance remettrait en cause la souveraineté des États, de plus en plus dépendants d’un pouvoir financier qui défend ses intérêts, loin de toute légitimité démocratique. Qui contrôle donc l’économie et la finance mondiale ? Quelques milliers d’entreprises et institutions privées, trop importantes et concentrées pour être contournables, et dont les liens organiques avec les pouvoirs politiques empêchent toute régulation digne de ce nom. Prenant le politique en otage, le capitalisme financier se préserve en même temps de toute répression. Pire, à la suite de la crise de 2008, les États sont même venus au secours des institutions qui s’étaient fourvoyées dans la frénésie spéculative des années 2000.
L’auteur perçoit, à travers ces évolutions, l’avènement d’un âge « post-politique » peut-être irréversible, car marquant « la fin de la démocratie telle que nous l’avons vécue depuis un siècle ». Appuyé par une plume facile, le propos est alarmiste, voire catastrophiste. Que la finance dépasse le politique ne signifie pas, pour autant, la démission de ce dernier. L’analyse se résume, par moments, à une succession d’exemples qui, aussi parlants soient-ils, ne prouvent pas pour autant que le crime financier ait gangréné, à jamais, l’ensemble de nos systèmes économiques.
J.-F. Gayraud adopte une lecture criminologique des systèmes politico-économiques contemporains, à rebours des sciences sociales, qui ont toujours renvoyé le crime à la périphérie du système. Selon l’auteur, l’imprégnation criminelle des systèmes économiques est telle qu’elle en vient à provoquer directement les crises économiques ou financières, comme au Japon ou en Albanie dans les années 1990, ou lors de la crise américaine de 2008. Les « narcobanques » américaines, qui ventilent l’argent des cartels mexicains, ou les banques du Golfe, qui financent le terrorisme, sont autant de symptômes d’un capitalisme malade, gangréné par une tumeur criminogène. Le livre détaille de nombreux exemples de dérives, pas toujours très récents, mais qui viennent alimenter la théorie de l’auteur. Un cas notoire est celui de la banque pakistanaise BCCI, qui fit faillite de façon spectaculaire en 1991 après avoir soutenu le crime et le terrorisme internationaux, tout en s’implantant dans la finance occidentale.
J.-F. Gayraud présente ensuite un nouveau mécanisme financier, qui illustre concrètement le potentiel de prédation permis par le système capitaliste. Le trading à haute fréquence, pratique encore méconnue en France mais déjà pratiquée par de nombreuses institutions financières, serait en effet la dernière dérive du capitalisme financier. Cette méthode, qui consiste à automatiser les transactions boursières afin d’en réaliser des milliers à la seconde, complexifie encore davantage le système financier contemporain. De plus en plus volatile et propice aux fraudes internes, la finance moderne exacerbe les risques de crises soudaines et imprévues. Plus grave encore, le fait que les dirigeants politiques ne sont plus à même de comprendre les dernières évolutions technologiques de la finance remettrait en cause la souveraineté des États, de plus en plus dépendants d’un pouvoir financier qui défend ses intérêts, loin de toute légitimité démocratique. Qui contrôle donc l’économie et la finance mondiale ? Quelques milliers d’entreprises et institutions privées, trop importantes et concentrées pour être contournables, et dont les liens organiques avec les pouvoirs politiques empêchent toute régulation digne de ce nom. Prenant le politique en otage, le capitalisme financier se préserve en même temps de toute répression. Pire, à la suite de la crise de 2008, les États sont même venus au secours des institutions qui s’étaient fourvoyées dans la frénésie spéculative des années 2000.
L’auteur perçoit, à travers ces évolutions, l’avènement d’un âge « post-politique » peut-être irréversible, car marquant « la fin de la démocratie telle que nous l’avons vécue depuis un siècle ». Appuyé par une plume facile, le propos est alarmiste, voire catastrophiste. Que la finance dépasse le politique ne signifie pas, pour autant, la démission de ce dernier. L’analyse se résume, par moments, à une succession d’exemples qui, aussi parlants soient-ils, ne prouvent pas pour autant que le crime financier ait gangréné, à jamais, l’ensemble de nos systèmes économiques.