See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
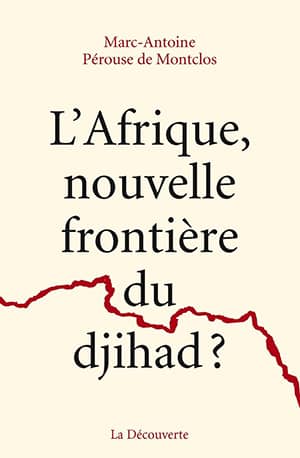
L’Afrique, nouvelle frontière du djihad
Par Marc-Antoine Pérouse de Montclos - Paris, La Découverte, 2018, 239p.
Après la publication de nombreux ouvrages sur les conflits locaux dans la zone sahélienne, voici une synthèse bienvenue sur le djihadisme affectant cette région. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a pris le parti de construire une démonstration répondant aux clichés et poncifs trop souvent lus et entendus sur ce thème et repris par les responsables politiques occidentaux. Cohérente et aisée à suivre, elle sacrifie toutefois la description des côtés sombres de ces mouvements, dont l’auteur n’évoque que rarement les méfaits.
L’ouvrage demeure cependant remarquable et rappelle quelques conclusions que la recherche peine encore à faire admettre pour conduire une réponse efficace à l’offensive de ces mouvements. En premier lieu, le djihadisme africain n’est pas réductible aux analyses habituelles portant sur les radicalisés européens ou les pratiques de l’État islamique. En Afrique moins qu’ailleurs, la dimension religieuse n’est pas l’explication essentielle : moins de la moitié des jeunes auraient rejoint les mouvements djihadistes pour des raisons religieuses (p. 128). Par ailleurs, l’intransigeance doctrinale est édulcorée lorsqu’il faut composer pour construire des alliances avec d’autres groupes, ou quand les contraintes de l’exercice du pouvoir obligent à écarter l’idéalisme théologique. L’histoire du djihad en Afrique est ancienne, et a permis de mobiliser des populations autour d’un chef charismatique ou pour défendre une communauté sans que la religion soit la motivation déterminante. Les particularités ethniques, régionales ou nationales prennent le dessus, et les djihadismes africains ne parviennent pas à fusionner dans un grand mouvement islamiste africain qui réaliserait enfin l’unité de l’oumma dans la région.
En deuxième lieu, le djihadisme se présente comme le résultat de l’échec des États issus de la décolonisation, mais également de l’aide au développement qui les a soutenus, souvent détournée par leurs dirigeants. Les mouvements naissent dans les régions les plus pauvres et les plus délaissées par les pouvoirs publics, même si les combattants sont loin de représenter une jacquerie de va-nu-pieds pillards. Le djihadisme exprime en particulier une révolte des jeunes contre une société qui n’offre non seulement aucun avenir, mais aussi parfois aucune éducation : « dans les principales régions où l’insurrection [Boko Haram] s’est développée, […] plus de 70 % de la population n’avait jamais été à l’école » (p. 139). Difficile, dans ces cas-là, d’accuser l’islamisme d’être à l’origine de l’obscurantisme. Tout au plus prospère-t-il sur un abandon de la jeunesse.
Les États de la région faillissent encore à leur mission lorsqu’ils luttent contre les rebelles, exerçant une répression très brutale, dont les exactions sont ensuite mises sur le compte des djihadistes, et qui nourrit un cycle de violences. Les armées occidentales, si elles interviennent avec plus d’égards pour les droits de l’homme, sont confrontées à une guerre difficile où il s’agit de gagner « les cœurs et les esprits », sans toutefois parvenir à fournir à la population les services publics essentiels qui font défaut. Considérant le djihadisme comme une extension de leur ennemi combattu dans les métropoles européennes ou en Irak, les Occidentaux peinent à comprendre les logiques locales. Du reste, ce djihadisme ne fait pas florès ailleurs, n’attirant que très peu de combattants étrangers.
Le tableau dépeint par l’auteur conduit à des conclusions finalement optimistes : le djihadisme est soluble dans l’exercice des responsabilités politiques. Force de mobilisation, la composante fondamentaliste de ces mouvements fond lorsqu’ils doivent diriger des communautés, voire des États (Somalie). Mais la réorientation des politiques de développement, qui s’affranchiraient de la volonté d’imiter le fonctionnement des États occidentaux et qui ramèneraient la corruption des dirigeants à des niveaux raisonnables, offre quelques raisons d’espérer.
L’ouvrage demeure cependant remarquable et rappelle quelques conclusions que la recherche peine encore à faire admettre pour conduire une réponse efficace à l’offensive de ces mouvements. En premier lieu, le djihadisme africain n’est pas réductible aux analyses habituelles portant sur les radicalisés européens ou les pratiques de l’État islamique. En Afrique moins qu’ailleurs, la dimension religieuse n’est pas l’explication essentielle : moins de la moitié des jeunes auraient rejoint les mouvements djihadistes pour des raisons religieuses (p. 128). Par ailleurs, l’intransigeance doctrinale est édulcorée lorsqu’il faut composer pour construire des alliances avec d’autres groupes, ou quand les contraintes de l’exercice du pouvoir obligent à écarter l’idéalisme théologique. L’histoire du djihad en Afrique est ancienne, et a permis de mobiliser des populations autour d’un chef charismatique ou pour défendre une communauté sans que la religion soit la motivation déterminante. Les particularités ethniques, régionales ou nationales prennent le dessus, et les djihadismes africains ne parviennent pas à fusionner dans un grand mouvement islamiste africain qui réaliserait enfin l’unité de l’oumma dans la région.
En deuxième lieu, le djihadisme se présente comme le résultat de l’échec des États issus de la décolonisation, mais également de l’aide au développement qui les a soutenus, souvent détournée par leurs dirigeants. Les mouvements naissent dans les régions les plus pauvres et les plus délaissées par les pouvoirs publics, même si les combattants sont loin de représenter une jacquerie de va-nu-pieds pillards. Le djihadisme exprime en particulier une révolte des jeunes contre une société qui n’offre non seulement aucun avenir, mais aussi parfois aucune éducation : « dans les principales régions où l’insurrection [Boko Haram] s’est développée, […] plus de 70 % de la population n’avait jamais été à l’école » (p. 139). Difficile, dans ces cas-là, d’accuser l’islamisme d’être à l’origine de l’obscurantisme. Tout au plus prospère-t-il sur un abandon de la jeunesse.
Les États de la région faillissent encore à leur mission lorsqu’ils luttent contre les rebelles, exerçant une répression très brutale, dont les exactions sont ensuite mises sur le compte des djihadistes, et qui nourrit un cycle de violences. Les armées occidentales, si elles interviennent avec plus d’égards pour les droits de l’homme, sont confrontées à une guerre difficile où il s’agit de gagner « les cœurs et les esprits », sans toutefois parvenir à fournir à la population les services publics essentiels qui font défaut. Considérant le djihadisme comme une extension de leur ennemi combattu dans les métropoles européennes ou en Irak, les Occidentaux peinent à comprendre les logiques locales. Du reste, ce djihadisme ne fait pas florès ailleurs, n’attirant que très peu de combattants étrangers.
Le tableau dépeint par l’auteur conduit à des conclusions finalement optimistes : le djihadisme est soluble dans l’exercice des responsabilités politiques. Force de mobilisation, la composante fondamentaliste de ces mouvements fond lorsqu’ils doivent diriger des communautés, voire des États (Somalie). Mais la réorientation des politiques de développement, qui s’affranchiraient de la volonté d’imiter le fonctionnement des États occidentaux et qui ramèneraient la corruption des dirigeants à des niveaux raisonnables, offre quelques raisons d’espérer.