See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
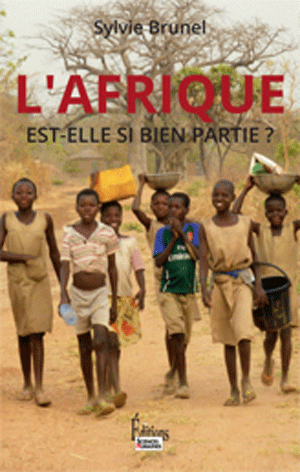
L’Afrique est-elle partie?
par Sylvie Brunel - Paris, Editions Sciences Humaines, 2014, 183p.
Plusieurs représentations de l’Afrique se chevauchent. La plus ancienne, qui remonte au brûlot prophétique de René Dumont (L’Afrique noire est mal partie, 1962), est celle d’un continent misérable, lesté par les héritages de l’esclavage et de la colonisation, dévasté par les guerres civiles, les famines et les pandémies. À cette vision pessimiste s’est surimposée, sans totalement l’effacer, une vision plus optimiste : celle d’une Afrique émergente, qui connaît des taux de croissance insolents, où s’enracine une classe moyenne, où s’ancre la démocratie tandis que recule le spectre de la guerre. Cette représentation a notamment été portée en France par Jean-Michel Sévérino (Le Temps de l’Afrique, 2010). Elle inspire désormais nos politiques publiques si l’on en croit les propositions du rapport Védrine-Zinsou (Un partenariat pour l’avenir. 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France, 2014) ou celles des sénateurs Jeanny Lorgeoux et Jean-Marie Bockel (L’Afrique est notre avenir, Rapport d’information de la commission des Affaires étrangères du Sénat, 2013-2014).
Avec une lucidité bienvenue, Sylvie Brunel tempère les excès de cette nouvelle bien-pensance. Si les Cassandre, tenants de l’afro-pessimisme, avaient tort, les afro-optimistes se trompent également : « Encenser l’Afrique paraît […] aussi excessif que l’accablement dont elle était hier l’objet. L’engouement qu’elle suscite est tout aussi caricatural que l’était le catastrophisme à tous crins des quinze ans qui ont suivi la fin de la guerre froide » (p. 12). Pour commencer, les uns et les autres se trompent en conjuguant l’Afrique au singulier. Comme Roland Pourtier (Afriques noires, Hachette, 2010), il faut se départir ainsi du regard extérieur qui lui confère une unité fallacieuse.
C’est en ayant conscience de l’immense diversité du continent africain que l’on évite, avec S. Brunel, les raccourcis simplificateurs. C’est ainsi par exemple que l’on ne se laissera emporter par un taux de croissance moyen. Sans doute le PIB africain a-t-il, dans son ensemble, connu une croissance annuelle de 5 % depuis une décennie, alors que les économies occidentales peinent toujours à se relever de la crise financière de 2008. Mais ce taux moyen cache bien des disparités. Disparités d’un pays à l’autre, l’essentiel de la croissance étant captée par quelques pays littoraux, riches en matières premières, ouverts sur les grandes aires de la mondialisation, alors que les pays enclavés végètent encore dans la très grande pauvreté. Disparités à l’intérieur d’un même pays : nombreux sont les États africains qui enregistrent, selon l’expression de l’économiste ghanéen Georges Ayittey, une « croissance sans développement », qui bénéficie à une poignée de riches sans toucher une majorité de pauvres, voire de très pauvres. Cette croissance inégale condamne l’Afrique à rester « un continent riche peuplé de pauvres » (p. 15) : la moitié de la population y vit encore avec moins de 1,25 dollar par jour.
Sans doute l’Afrique est-elle sortie de ce que Sylvie Brunel qualifie de « décennie du chaos » (p. 68). Pour autant, les hypothèques sont nombreuses sur la voie du développement. Le catalogue qu’elle en dresse est classique : le défi de l’urbanisation, celui de l’alimentation – que l’auteur de l’excellent Famines et politique (2002), régulièrement réédité aux Presses de Sciences Po, connaît bien –, la difficile acculturation de la démocratie, la transition vers un mix énergétique moins gourmand en énergies non renouvelables grâce à l’exploitation des rentes bleue – l’hydroélectricité – et jaune – l’énergie solaire –, la fragile émergence d’une classe moyenne, etc.
Avec une lucidité bienvenue, Sylvie Brunel tempère les excès de cette nouvelle bien-pensance. Si les Cassandre, tenants de l’afro-pessimisme, avaient tort, les afro-optimistes se trompent également : « Encenser l’Afrique paraît […] aussi excessif que l’accablement dont elle était hier l’objet. L’engouement qu’elle suscite est tout aussi caricatural que l’était le catastrophisme à tous crins des quinze ans qui ont suivi la fin de la guerre froide » (p. 12). Pour commencer, les uns et les autres se trompent en conjuguant l’Afrique au singulier. Comme Roland Pourtier (Afriques noires, Hachette, 2010), il faut se départir ainsi du regard extérieur qui lui confère une unité fallacieuse.
C’est en ayant conscience de l’immense diversité du continent africain que l’on évite, avec S. Brunel, les raccourcis simplificateurs. C’est ainsi par exemple que l’on ne se laissera emporter par un taux de croissance moyen. Sans doute le PIB africain a-t-il, dans son ensemble, connu une croissance annuelle de 5 % depuis une décennie, alors que les économies occidentales peinent toujours à se relever de la crise financière de 2008. Mais ce taux moyen cache bien des disparités. Disparités d’un pays à l’autre, l’essentiel de la croissance étant captée par quelques pays littoraux, riches en matières premières, ouverts sur les grandes aires de la mondialisation, alors que les pays enclavés végètent encore dans la très grande pauvreté. Disparités à l’intérieur d’un même pays : nombreux sont les États africains qui enregistrent, selon l’expression de l’économiste ghanéen Georges Ayittey, une « croissance sans développement », qui bénéficie à une poignée de riches sans toucher une majorité de pauvres, voire de très pauvres. Cette croissance inégale condamne l’Afrique à rester « un continent riche peuplé de pauvres » (p. 15) : la moitié de la population y vit encore avec moins de 1,25 dollar par jour.
Sans doute l’Afrique est-elle sortie de ce que Sylvie Brunel qualifie de « décennie du chaos » (p. 68). Pour autant, les hypothèques sont nombreuses sur la voie du développement. Le catalogue qu’elle en dresse est classique : le défi de l’urbanisation, celui de l’alimentation – que l’auteur de l’excellent Famines et politique (2002), régulièrement réédité aux Presses de Sciences Po, connaît bien –, la difficile acculturation de la démocratie, la transition vers un mix énergétique moins gourmand en énergies non renouvelables grâce à l’exploitation des rentes bleue – l’hydroélectricité – et jaune – l’énergie solaire –, la fragile émergence d’une classe moyenne, etc.