See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
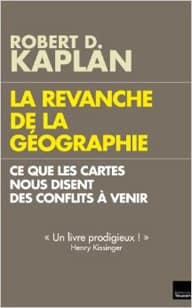
La revanche de la géographie. Ce que les cartes nous disent des conflits à venir
par Robert Kaplan - Paris, Éditions du Toucan, 2014, 528 p.
Robert Kaplan fait partie de ces grands reporters qui, pour avoir beaucoup voyagé et croisé d’innombrables personnalités remarquables, se sentent la carrure d’un « spécialiste des questions internationales ». Prétention absurde tant celles-ci sont multiples, complexes, interdisant toute spécialisation autre que sur un segment étroit. Il tente pourtant depuis près de trente ans de donner sa vision du monde et de la politique étrangère américaine. À ce jeu, il a recueilli de nombreux lauriers mais aussi de multiples horions.
C’est plutôt cette dernière catégorie de récompenses que recevra sans doute son dernier livre, La revanche de la géographie. Ce que les cartes nous disent des conflits à venir. Certes, l’intention de départ est bonne. L’idée de redonner à la géographie toute son importance semble essentielle à l’heure où bien des Américains situent la Suisse à l’emplacement de la Belgique, médiocrité partagée par la majorité des Français. Mais la géographie n’est pas qu’un ensemble de facteurs physiques. Il existe aussi une géographie humaine (démographie, aménagement du territoire, etc.) essentielle, que R. Kaplan laisse volontiers de côté ou survole. Et s’il est surtout une science indissociable de la géographie en matière de relations internationales, c’est bien l’histoire. Un domaine que l’auteur semble maîtriser au premier abord, tant il s’adonne avec délectation à l’étalage d’érudition, mais sur lequel il est tout à fait approximatif : les Égyptiens ont connu bien des envahisseurs en quatre mille ans, des peuples de la mer jusqu’aux Arabes, en passant par les Hyksos ; et le « règne ottoman » ne s’est jamais étendu jusqu’au Bengale, puisqu’il était contenu sur sa frontière orientale par l’Iran.
Perfectible du point de vue de la connaissance, R. Kaplan s’appuie pourtant sur tous les grands noms de la réflexion géopolitique. Mais les évoquer n’est pas les égaler. R. Kaplan se hisse sur les épaules de géants dont il n’a pas le talent pour asséner des thèses brutales qui n’aboutissent qu’à une chose : semer un peu plus la méfiance vis-à-vis des États-Unis. Car la franchise avec laquelle il dévoile sa vision de ce que devrait être la diplomatie américaine ne laisse guère de doute sur la volonté de toute puissance que certains cultivent à Washington. Louant Nicholas Spykman, il rappelle que celui-ci « exhorte les États-Unis à prendre conscience de l’énorme avantage que leur confère leur hégémonie régionale sur les autres pays de l’hémisphère Nord […] Aucune autre nation au monde, qu’il s’agisse même de la Chine ou de la Russie, n’est hégémonique dans de telles proportions. » La Maison-Blanche a pris de longue date conscience de cet atout. Citant encore N. Spykman, l’auteur insiste sur la nécessité de faire obstacle à la constitution d’une « Europe fédérale unie [parce qu’elle] deviendrait si forte qu’elle mettrait en danger notre mainmise sur l’Atlantique et notre position dominante dans le monde occidental », ce qui achèvera de convaincre ceux qui considèrent que les États-Unis voient d’un mauvais œil l’avènement d’une Europe-puissance.
On l’aura compris, R. Kaplan se rêve en Henry Kissinger. Mais il n’a pas la justesse de son analyse ni la finesse de son expression. Vulgarisateur, manieur d’idées, l’auteur essaie de s’élever au niveau d’un Samuel Huntington. Il culmine à celui d’un Bernard-Henri Lévy. Même vision simpliste, même manichéisme, même amour du point Godwin. Très content de lui lorsqu’il évoque son influence supposée sur la politique balkanique de Bill Clinton, avouant sans vergogne son appartenance à des groupes de pression ayant soutenu l’invasion de l’Irak en 2003 parce qu’on « croyait qu’elle avait des armes chimiques » – crédulité savoureuse pour un spécialiste –, R. Kaplan a au moins, par moments, l’avantage d’être réaliste. « Ce n’est pas en idéalisant les choses qu’on s’emploiera à les changer », assène-t-il. En les simplifiant non plus.
C’est plutôt cette dernière catégorie de récompenses que recevra sans doute son dernier livre, La revanche de la géographie. Ce que les cartes nous disent des conflits à venir. Certes, l’intention de départ est bonne. L’idée de redonner à la géographie toute son importance semble essentielle à l’heure où bien des Américains situent la Suisse à l’emplacement de la Belgique, médiocrité partagée par la majorité des Français. Mais la géographie n’est pas qu’un ensemble de facteurs physiques. Il existe aussi une géographie humaine (démographie, aménagement du territoire, etc.) essentielle, que R. Kaplan laisse volontiers de côté ou survole. Et s’il est surtout une science indissociable de la géographie en matière de relations internationales, c’est bien l’histoire. Un domaine que l’auteur semble maîtriser au premier abord, tant il s’adonne avec délectation à l’étalage d’érudition, mais sur lequel il est tout à fait approximatif : les Égyptiens ont connu bien des envahisseurs en quatre mille ans, des peuples de la mer jusqu’aux Arabes, en passant par les Hyksos ; et le « règne ottoman » ne s’est jamais étendu jusqu’au Bengale, puisqu’il était contenu sur sa frontière orientale par l’Iran.
Perfectible du point de vue de la connaissance, R. Kaplan s’appuie pourtant sur tous les grands noms de la réflexion géopolitique. Mais les évoquer n’est pas les égaler. R. Kaplan se hisse sur les épaules de géants dont il n’a pas le talent pour asséner des thèses brutales qui n’aboutissent qu’à une chose : semer un peu plus la méfiance vis-à-vis des États-Unis. Car la franchise avec laquelle il dévoile sa vision de ce que devrait être la diplomatie américaine ne laisse guère de doute sur la volonté de toute puissance que certains cultivent à Washington. Louant Nicholas Spykman, il rappelle que celui-ci « exhorte les États-Unis à prendre conscience de l’énorme avantage que leur confère leur hégémonie régionale sur les autres pays de l’hémisphère Nord […] Aucune autre nation au monde, qu’il s’agisse même de la Chine ou de la Russie, n’est hégémonique dans de telles proportions. » La Maison-Blanche a pris de longue date conscience de cet atout. Citant encore N. Spykman, l’auteur insiste sur la nécessité de faire obstacle à la constitution d’une « Europe fédérale unie [parce qu’elle] deviendrait si forte qu’elle mettrait en danger notre mainmise sur l’Atlantique et notre position dominante dans le monde occidental », ce qui achèvera de convaincre ceux qui considèrent que les États-Unis voient d’un mauvais œil l’avènement d’une Europe-puissance.
On l’aura compris, R. Kaplan se rêve en Henry Kissinger. Mais il n’a pas la justesse de son analyse ni la finesse de son expression. Vulgarisateur, manieur d’idées, l’auteur essaie de s’élever au niveau d’un Samuel Huntington. Il culmine à celui d’un Bernard-Henri Lévy. Même vision simpliste, même manichéisme, même amour du point Godwin. Très content de lui lorsqu’il évoque son influence supposée sur la politique balkanique de Bill Clinton, avouant sans vergogne son appartenance à des groupes de pression ayant soutenu l’invasion de l’Irak en 2003 parce qu’on « croyait qu’elle avait des armes chimiques » – crédulité savoureuse pour un spécialiste –, R. Kaplan a au moins, par moments, l’avantage d’être réaliste. « Ce n’est pas en idéalisant les choses qu’on s’emploiera à les changer », assène-t-il. En les simplifiant non plus.