See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
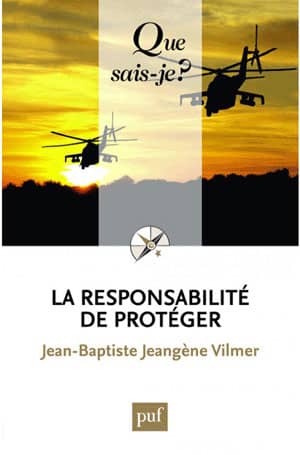
La responsabilité de protéger
Par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer - Paris, Presses universitaires de France, 2015, 128p.
Le concept est à la mode. Brandi avec excès par ceux qui y voient une solution à toutes les crises du monde, honni par les autres qui le suspectent de cautionner un nouvel interventionnisme occidental, il est mal compris. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer en fait la généalogie, en précise les contours et en présente les modalités de mise en œuvre.
Apparue en 2001 sous la plume des experts de la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des États, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2005, la responsabilité de protéger (R2P) est le produit d’une longue histoire qui ne date pas de la chute du mur de Berlin. En effet, la souveraineté n’a jamais été absolue. Déjà au XIXe siècle, l’« intervention d’humanité » autorise l’intervention militaire aux fins de protection des populations. En 1945, si l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies consacre le principe de souveraineté étatique, celui-ci ne prohibe pas toute intervention militaire, toujours possible avec l’autorisation du Conseil de sécurité sous chapitre VII. Le droit international des droits de l’homme – la Convention contre le génocide de 1948 par exemple – et le droit international humanitaire – la Convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels – imposent aux États des responsabilités dont la méconnaissance est, en théorie, sanctionnée.
La R2P n’en reste pas moins le produit de l’histoire récente. La chute du Mur a entraîné avec elle les obstacles à l’interventionnisme. Les années 1990 sont l’âge d’or des opérations de maintien de la paix, désormais menées sous chapitre VII, sans qu’aucun veto des grandes puissances n’ose y faire objection. Elles voient aussi se multiplier les « non-interventions inhumanitaires », selon la fine expression de Simon Chesterman, désignant des situations où la « communauté internationale » n’a pas réussi à se mobiliser (Rwanda, République démocratique du Congo, Somalie, etc.). Le temps est mûr pour un nouveau principe.
La résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 16 septembre 2005 ne consacre pas une, mais deux R2P : celle, principale, de l’État qui doit protéger ses populations de quatre crimes limitativement énumérés – génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité – et celle, subsidiaire, de la communauté internationale qui peut, sur autorisation du secrétaire général des Nations unies, se substituer à l’État qui manque à son obligation. Tous les mots comptent dans cette définition, qui débute par une réaffirmation fort orthodoxe de la souveraineté étatique. Que vise-t-elle ? Les manquements des États à protéger contre quatre crimes seulement. Qui vise-t-elle ? Les populations, ce qui inclut les réfugiés résidant sur le territoire, mais ne saurait être étendu aux diasporas à l’étranger. Quand la protection subsidiaire peut-elle jouer ? Si et seulement si le Conseil de sécurité l’autorise. La mise en œuvre de cette protection subsidiaire est-elle un devoir qui pèse sur la communauté internationale ? Non, c’est une option, pas une obligation.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer consacre la fin de son court ouvrage à montrer comment la R2P a été mise en œuvre depuis 2005. Le consensus qui avait entouré son adoption ne doit pas faire illusion. La R2P inquiète tous les États : les plus faibles qui craignent qu’elle ne permette la violation de leur souveraineté, les plus forts qui redoutent qu’elle ne les oblige à intervenir sur des terrains où ils ne souhaitent pas être impliqués. Son utilisation en Libye en 2011 a failli lui être fatale, certains États lui reprochant d’avoir été dévoyée pour permettre un changement de régime. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer s’inscrit en faux contre cette analyse, répondant que la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies ne faisait pas du renversement de Mouammar Kadhafi un objectif, mais l’autorisait implicitement comme moyen de protéger les civils. Qu’on le rejoigne ou pas dans cette analyse, force est de constater que le précédent libyen a laissé des traces durables, qui expliquent en large partie les veto russe et chinois contre toute intervention en Syrie.
Apparue en 2001 sous la plume des experts de la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des États, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2005, la responsabilité de protéger (R2P) est le produit d’une longue histoire qui ne date pas de la chute du mur de Berlin. En effet, la souveraineté n’a jamais été absolue. Déjà au XIXe siècle, l’« intervention d’humanité » autorise l’intervention militaire aux fins de protection des populations. En 1945, si l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies consacre le principe de souveraineté étatique, celui-ci ne prohibe pas toute intervention militaire, toujours possible avec l’autorisation du Conseil de sécurité sous chapitre VII. Le droit international des droits de l’homme – la Convention contre le génocide de 1948 par exemple – et le droit international humanitaire – la Convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels – imposent aux États des responsabilités dont la méconnaissance est, en théorie, sanctionnée.
La R2P n’en reste pas moins le produit de l’histoire récente. La chute du Mur a entraîné avec elle les obstacles à l’interventionnisme. Les années 1990 sont l’âge d’or des opérations de maintien de la paix, désormais menées sous chapitre VII, sans qu’aucun veto des grandes puissances n’ose y faire objection. Elles voient aussi se multiplier les « non-interventions inhumanitaires », selon la fine expression de Simon Chesterman, désignant des situations où la « communauté internationale » n’a pas réussi à se mobiliser (Rwanda, République démocratique du Congo, Somalie, etc.). Le temps est mûr pour un nouveau principe.
La résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 16 septembre 2005 ne consacre pas une, mais deux R2P : celle, principale, de l’État qui doit protéger ses populations de quatre crimes limitativement énumérés – génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité – et celle, subsidiaire, de la communauté internationale qui peut, sur autorisation du secrétaire général des Nations unies, se substituer à l’État qui manque à son obligation. Tous les mots comptent dans cette définition, qui débute par une réaffirmation fort orthodoxe de la souveraineté étatique. Que vise-t-elle ? Les manquements des États à protéger contre quatre crimes seulement. Qui vise-t-elle ? Les populations, ce qui inclut les réfugiés résidant sur le territoire, mais ne saurait être étendu aux diasporas à l’étranger. Quand la protection subsidiaire peut-elle jouer ? Si et seulement si le Conseil de sécurité l’autorise. La mise en œuvre de cette protection subsidiaire est-elle un devoir qui pèse sur la communauté internationale ? Non, c’est une option, pas une obligation.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer consacre la fin de son court ouvrage à montrer comment la R2P a été mise en œuvre depuis 2005. Le consensus qui avait entouré son adoption ne doit pas faire illusion. La R2P inquiète tous les États : les plus faibles qui craignent qu’elle ne permette la violation de leur souveraineté, les plus forts qui redoutent qu’elle ne les oblige à intervenir sur des terrains où ils ne souhaitent pas être impliqués. Son utilisation en Libye en 2011 a failli lui être fatale, certains États lui reprochant d’avoir été dévoyée pour permettre un changement de régime. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer s’inscrit en faux contre cette analyse, répondant que la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies ne faisait pas du renversement de Mouammar Kadhafi un objectif, mais l’autorisait implicitement comme moyen de protéger les civils. Qu’on le rejoigne ou pas dans cette analyse, force est de constater que le précédent libyen a laissé des traces durables, qui expliquent en large partie les veto russe et chinois contre toute intervention en Syrie.