See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
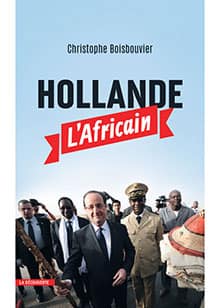
Hollande l’Africain
Par Christophe Boisbouvier - Paris, La Découverte, 2015, 335p.
Journaliste à RFI et collaborateur de l’hebdomadaire Jeune Afrique, Christophe Boisbouvier présente une histoire des relations entre le Parti socialiste et l’Afrique sur les trente dernières années. D’une grande clarté et évitant le ton polémique, il montre que le discours moral en matière de politique étrangère résiste mal à l’épreuve des faits, surtout dans un contexte aussi complexe que celui de l’Afrique.
Le 58e engagement de campagne du candidat Hollande affirmait : « je romprai avec la Françafrique, en proposant une relation fondée sur l’égalité, la confiance et la solidarité ». Cinq ans auparavant, le candidat Sarkozy avait laissé entendre peu ou prou la même chose. Son nouveau secrétaire d’État à la Coopération, Jean-Marie Bockel, trop courageux ou trop naïf, avait eu le tort d’y croire, ce qui lui avait valu d’être « déplacé » à la Défense et aux Anciens combattants.
La politique du président socialiste nouvellement élu a bien marqué une certaine rupture avec les anciennes pratiques, jusqu’à un certain point toutefois. D’un côté, une nouvelle équipe (Hélène Le Gal, Pascal Canfin, Thomas Melonio) a incarné une approche différente des affaires africaines, en phase avec l’opinion commune aux organisations non gouvernementales (ONG) et la doctrine des diplomates. Mais, de l’autre, la France n’étant pas la Norvège, le président François Hollande s’est retrouvé à devoir affronter des situations dramatiques, puis à se résoudre à des compromis parfois amers. Il est vrai que les débuts de sa politique africaine ont été marqués par quelques gestes forts, notamment la volonté de rappeler à certains dictateurs le respect des droits de l’homme, l’assouplissement de certains aspects de la politique migratoire française et la reconnaissance d’un passé franco-africain parfois douloureux. Le rapprochement franco-algérien, bien que limité, contraste en effet avec la période précédente.
Mais très vite, F. Hollande a dû dépasser cette approche prudente. Les conséquences de l’effondrement de la zone sahélienne, aux mains des djihadistes, l’ont obligé à agir. Les militaires vont alors prendre l’ascendant sur le président et le convaincre de lire autrement la réalité africaine. Sous leur influence, il se résout à l’intervention armée. L’espoir d’une prise en main de leur sécurité par les Africains ne résiste ainsi pas à l’épreuve des faits au Mali, puis en République centrafricaine (RCA). Le succès de l’intervention au Mali a conforté cette intuition et les difficultés rencontrées en RCA n’invalident pas ce choix, qui a évité bien des victimes dans un pays plongé dans le chaos.
La rupture est également limitée dans le domaine économique, la défense des intérêts français sur le continent se retrouvant désormais au centre de l’action du Quai d’Orsay. La vertu doit concéder quelque place à la nécessité au moment où l’enjeu principal de la présidence se concentre, en France, sur la lutte contre le chômage. Cette priorité explique-t-elle la poursuite des relations avec des présidents très controversés ? Lorsque certains chefs d’État africains manipulent la Constitution pour s’accrocher au pouvoir, voire répriment dans le sang l’opposition politique, Paris hésite. Le président F. Hollande a ainsi habilement su abandonner Blaise Compaoré, mais a manqué de fermeté ou s’est tu face aux méfaits d’un Paul Kagamé, d’un Paul Biya, d’un Joseph Kabila, etc. Par ailleurs, d’autres dirigeants socialistes nouent des liens avec les milieux dirigeants africains afin de consolider leur propre position nationale : le Premier ministre, notamment, peut-être tenté par un destin de chef d’État.
Réseaux, compromis, intermédiaires, soutiens à des dictateurs autrefois décriés : le réalisme était inévitable. La France reste une grande puissance, du moins en Afrique, et il faut accepter les contraintes liées à ce statut. Les pratiques perdurent, même s’il semble qu’une certaine transparence en la matière s’installe progressivement. L’auteur conclut sur les deux leçons enseignées par l’Afrique à F. Hollande : qu’il sait se comporter en chef de guerre victorieux, et qu’un homme d’État échappe difficilement aux désillusions suscitées par la corruption du pouvoir.
Le 58e engagement de campagne du candidat Hollande affirmait : « je romprai avec la Françafrique, en proposant une relation fondée sur l’égalité, la confiance et la solidarité ». Cinq ans auparavant, le candidat Sarkozy avait laissé entendre peu ou prou la même chose. Son nouveau secrétaire d’État à la Coopération, Jean-Marie Bockel, trop courageux ou trop naïf, avait eu le tort d’y croire, ce qui lui avait valu d’être « déplacé » à la Défense et aux Anciens combattants.
La politique du président socialiste nouvellement élu a bien marqué une certaine rupture avec les anciennes pratiques, jusqu’à un certain point toutefois. D’un côté, une nouvelle équipe (Hélène Le Gal, Pascal Canfin, Thomas Melonio) a incarné une approche différente des affaires africaines, en phase avec l’opinion commune aux organisations non gouvernementales (ONG) et la doctrine des diplomates. Mais, de l’autre, la France n’étant pas la Norvège, le président François Hollande s’est retrouvé à devoir affronter des situations dramatiques, puis à se résoudre à des compromis parfois amers. Il est vrai que les débuts de sa politique africaine ont été marqués par quelques gestes forts, notamment la volonté de rappeler à certains dictateurs le respect des droits de l’homme, l’assouplissement de certains aspects de la politique migratoire française et la reconnaissance d’un passé franco-africain parfois douloureux. Le rapprochement franco-algérien, bien que limité, contraste en effet avec la période précédente.
Mais très vite, F. Hollande a dû dépasser cette approche prudente. Les conséquences de l’effondrement de la zone sahélienne, aux mains des djihadistes, l’ont obligé à agir. Les militaires vont alors prendre l’ascendant sur le président et le convaincre de lire autrement la réalité africaine. Sous leur influence, il se résout à l’intervention armée. L’espoir d’une prise en main de leur sécurité par les Africains ne résiste ainsi pas à l’épreuve des faits au Mali, puis en République centrafricaine (RCA). Le succès de l’intervention au Mali a conforté cette intuition et les difficultés rencontrées en RCA n’invalident pas ce choix, qui a évité bien des victimes dans un pays plongé dans le chaos.
La rupture est également limitée dans le domaine économique, la défense des intérêts français sur le continent se retrouvant désormais au centre de l’action du Quai d’Orsay. La vertu doit concéder quelque place à la nécessité au moment où l’enjeu principal de la présidence se concentre, en France, sur la lutte contre le chômage. Cette priorité explique-t-elle la poursuite des relations avec des présidents très controversés ? Lorsque certains chefs d’État africains manipulent la Constitution pour s’accrocher au pouvoir, voire répriment dans le sang l’opposition politique, Paris hésite. Le président F. Hollande a ainsi habilement su abandonner Blaise Compaoré, mais a manqué de fermeté ou s’est tu face aux méfaits d’un Paul Kagamé, d’un Paul Biya, d’un Joseph Kabila, etc. Par ailleurs, d’autres dirigeants socialistes nouent des liens avec les milieux dirigeants africains afin de consolider leur propre position nationale : le Premier ministre, notamment, peut-être tenté par un destin de chef d’État.
Réseaux, compromis, intermédiaires, soutiens à des dictateurs autrefois décriés : le réalisme était inévitable. La France reste une grande puissance, du moins en Afrique, et il faut accepter les contraintes liées à ce statut. Les pratiques perdurent, même s’il semble qu’une certaine transparence en la matière s’installe progressivement. L’auteur conclut sur les deux leçons enseignées par l’Afrique à F. Hollande : qu’il sait se comporter en chef de guerre victorieux, et qu’un homme d’État échappe difficilement aux désillusions suscitées par la corruption du pouvoir.