See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
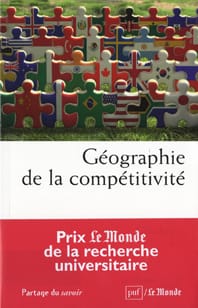
Géographie de la compétitivité
par Gilles Ardinat - Paris, Presses universitaires de France, 2013, 208 p.
La compétitivité est un terme galvaudé du débat économique et social contemporain. Le concept a été monopolisé par les économistes. Alors qu’il s’applique à des territoires, il est ignoré des géographes. Agrégé de géographie et auteur d’une thèse récompensée par le prix Le Monde de la recherche universitaire, Gilles Ardinat dénonce ce paradoxe et propose d’y remédier. Constatant la « misère cartographique » (p. 7) qui entoure ce concept, il met la compétitivité en cartes. La tâche n’est pas simple car cette notion, pour intuitive qu’elle soit, n’est pas aisée à définir. Alors qu’elle occupe une place grandissante dans le débat public, aucune méthode de mesure précise ne s’est encore imposée.
Les classements sur la compétitivité nationale se sont multipliés ces dernières années au point de faire naître un business fructueux de géoéconomistes autoproclamés, ainsi du Global Competitiveness Report publié en marge du Forum de Davos ou du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ces classements reposent sur des variables composites qui mélangent des logiques de moyens et de résultats. Ils tentent de concilier deux approches de la compétitivité : d’un côté, une dimension néo-mercantiliste qui fait de l’ouverture commerciale le critère-clé ; de l’autre, une approche attractiviste qui mesure la compétitivité à l’aune de la capacité du territoire à attirer les investissements étrangers. Ces deux approches sont contradictoires. La première est agressive, fondée sur les exportations. La seconde, au contraire, insiste sur le pouvoir de séduction d’un territoire. Elles constituent, par ailleurs, « une injonction contradictoire aux nations » (p. 88). L’augmentation des exportations suppose, en effet, la compression des coûts de production (modération salariale, allègement de la fiscalité des entreprises). Sans doute une telle politique est-elle susceptible d’attirer les investisseurs étrangers. Mais l’attractivité d’un territoire suppose aussi une main-d’œuvre bien formée, des infrastructures de qualité, autant d’externalités positives dont le coût excède les ressources d’un État confronté à la diminution, de ses rentrées fiscales.
G. Ardinat ne se contente pas de pointer ces seules contradictions. Il souligne l’inefficacité de la « gouvernance compétititive » (p. 123). Il critique l’assimilation faite par Michael Porter de la nation à une firme, une analogie trompeuse qui néglige leurs modes opératoires, leurs finalités respectives et leurs temporalités différentes. La compression des coûts de production pour encourager le commerce international ? Une politique dangereuse qui déprime la demande intérieure. L’attractivité ? Une politique publique fondée sur le postulat discutable des bienfaits des investissements directs étrangers, quelles que soient leurs caractéristiques.
C’est un procès en règle que l’auteur instruit contre l’idéologie libérale, qui sous-tend la notion de compétitivité. Il y voit un processus qui entend conformer la société aux attentes des firmes multinationales et réduire le citoyen à un simple salarié. Estimant que l’accent mis sur la compétitivité constitue une rhétorique qui accompagne une perte de souveraineté, il s’insurge contre une telle capitulation et appelle à un réarmement statistique – il faut se doter des indices permettant de planter le débat – et démocratique – il faut remettre en cause le « biais mondialiste » (p. 78) qui caractérise tous les partis de gouvernement, de droite comme de gauche. Constatant l’inefficacité des politiques de compétitivité – et le péché d’orgueil de l’Occident à espérer pouvoir conserver sa supériorité dans la division internationale du travail –, il conclut sa démonstration par un appel au néoprotectionnisme.
Les classements sur la compétitivité nationale se sont multipliés ces dernières années au point de faire naître un business fructueux de géoéconomistes autoproclamés, ainsi du Global Competitiveness Report publié en marge du Forum de Davos ou du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ces classements reposent sur des variables composites qui mélangent des logiques de moyens et de résultats. Ils tentent de concilier deux approches de la compétitivité : d’un côté, une dimension néo-mercantiliste qui fait de l’ouverture commerciale le critère-clé ; de l’autre, une approche attractiviste qui mesure la compétitivité à l’aune de la capacité du territoire à attirer les investissements étrangers. Ces deux approches sont contradictoires. La première est agressive, fondée sur les exportations. La seconde, au contraire, insiste sur le pouvoir de séduction d’un territoire. Elles constituent, par ailleurs, « une injonction contradictoire aux nations » (p. 88). L’augmentation des exportations suppose, en effet, la compression des coûts de production (modération salariale, allègement de la fiscalité des entreprises). Sans doute une telle politique est-elle susceptible d’attirer les investisseurs étrangers. Mais l’attractivité d’un territoire suppose aussi une main-d’œuvre bien formée, des infrastructures de qualité, autant d’externalités positives dont le coût excède les ressources d’un État confronté à la diminution, de ses rentrées fiscales.
G. Ardinat ne se contente pas de pointer ces seules contradictions. Il souligne l’inefficacité de la « gouvernance compétititive » (p. 123). Il critique l’assimilation faite par Michael Porter de la nation à une firme, une analogie trompeuse qui néglige leurs modes opératoires, leurs finalités respectives et leurs temporalités différentes. La compression des coûts de production pour encourager le commerce international ? Une politique dangereuse qui déprime la demande intérieure. L’attractivité ? Une politique publique fondée sur le postulat discutable des bienfaits des investissements directs étrangers, quelles que soient leurs caractéristiques.
C’est un procès en règle que l’auteur instruit contre l’idéologie libérale, qui sous-tend la notion de compétitivité. Il y voit un processus qui entend conformer la société aux attentes des firmes multinationales et réduire le citoyen à un simple salarié. Estimant que l’accent mis sur la compétitivité constitue une rhétorique qui accompagne une perte de souveraineté, il s’insurge contre une telle capitulation et appelle à un réarmement statistique – il faut se doter des indices permettant de planter le débat – et démocratique – il faut remettre en cause le « biais mondialiste » (p. 78) qui caractérise tous les partis de gouvernement, de droite comme de gauche. Constatant l’inefficacité des politiques de compétitivité – et le péché d’orgueil de l’Occident à espérer pouvoir conserver sa supériorité dans la division internationale du travail –, il conclut sa démonstration par un appel au néoprotectionnisme.