See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
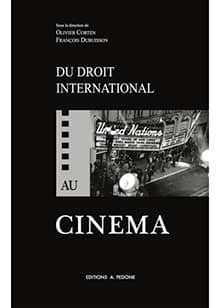
Du droit international au cinéma
Par Olivier Corten et François Dubuisson (dir.) - Paris, Éditions A. Pedone, 2015, 398p.
Le cinéma a sa géopolitique : il est né sur le Vieux Continent, s’est très vite exporté outre-Atlantique, où Hollywood a mis en images le « siècle américain », et connaît depuis peu un développement multipolaire (Bollywood, Nollywood, etc.). La géopolitique a symétriquement son cinéma : nombreux sont les films ou les séries télévisées qui traitent des relations internationales, tendant au monde un miroir dont le reflet peut s’avérer fidèle ou déformé, que l’on pense aux films d’espionnage (James Bond, OSS 117, 24 heures chrono, etc.), aux films de guerre (« Il faut sauver le soldat Ryan », « Platoon », « Black Hawk Down », etc.) ou encore aux films catastrophe (« Independence Day », « Armageddon », « La somme de toutes les peurs », etc.).
Ces films ne consacrent au droit international qu’une place limitée. La raison en est logique : le droit n’est pas dramaturgique. Rien de moins cinématographique qu’une guerre évitée par la diplomatie préventive, qu’une négociation qui apaise les tensions. C’est pourtant à ce thème que le Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles a consacré, en janvier 2014, le colloque célébrant son cinquantième anniversaire. Cinéphiles chevronnés ou simples amateurs du septième art, la douzaine de juristes réunis autour d’Olivier Corten et François Dubuisson ont éclusé une monumentale filmographie principalement constituée de films grand public et de séries télévisées.
En le cherchant bien, on trouve du droit international public – car le droit international privé n’a guère eu les faveurs des cinéastes – dans nombre de films. Franck Latty montre par exemple que les règles de la lex sportiva sont un enjeu des « Chariots de feu » ou de « Rasta Rockett » – à la date du colloque, le film consacré à Lance Armstrong, « The Program », n’était pas encore sorti. Il en va de même dans les films de science-fiction, où les rapports aux extraterrestres sont en fait une allégorie des rapports entre humains – c’est le cas par exemple de « E.T. », « X-Men », « Avatar » ou « District 9 ».
Mais c’est dans les films de guerre que le droit international est logiquement le plus souvent convoqué. Les règles limitant le recours à la force – le jus ad bellum – y sont régulièrement violées. Soit qu’elles empêchent de se défendre d’une attaque : c’est l’idéalisme moqué des présidents français et américains qui négocient avec les envahisseurs dans « Mars Attacks ! ». Soit qu’elles protègent les États voyous des interventions d’humanité en réaction aux violations des droits humains dont ils se rendent coupables : c’est Rambo qui est ainsi envoyé en Birmanie au mépris de la souveraineté de cet État. Une fois la guerre déclarée, les règles qui encadrent l’usage de la force – le jus in bellum – apparaissent elles aussi comme inutilement paralysantes : dans « Zero Dark Thirty », la Central Intelligence Agency (CIA) torture impunément pour obtenir des informations permettant de traquer Oussama Ben Laden.
Pour autant, le droit international n’est pas toujours tourné en ridicule. Le jus post bellum constitue, à ce titre, un contre-exemple éclairant. Anne Lagerwall montre que « le cinéma affiche plus volontiers son soutien que sa méfiance à l’égard de la justice pénale internationale » (p. 242) – même si aucun procès pénal international n’a, jusqu’à présent, été encore porté à l’écran, à la seule exception du procès de Nuremberg.
Le sujet de ce livre peut sembler frivole. On pourrait se moquer du plaisir que ce synode de doctes juristes a probablement pris à discuter de l’application de la Charte des Nations unies dans « Bernard et Bianca » et de la Convention de Genève dans « Le Pont de la rivière Kwaï ». Cette ironie facile sous-estime l’audience de ces films, qui reflètent la conception que se fait l’opinion publique du droit international autant qu’ils la façonnent. Les États-Unis ne l’ignorent pas, et Hollywood, le Pentagone et la Maison-Blanche entretiennent depuis longtemps des relations incestueuses.
Ces films ne consacrent au droit international qu’une place limitée. La raison en est logique : le droit n’est pas dramaturgique. Rien de moins cinématographique qu’une guerre évitée par la diplomatie préventive, qu’une négociation qui apaise les tensions. C’est pourtant à ce thème que le Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles a consacré, en janvier 2014, le colloque célébrant son cinquantième anniversaire. Cinéphiles chevronnés ou simples amateurs du septième art, la douzaine de juristes réunis autour d’Olivier Corten et François Dubuisson ont éclusé une monumentale filmographie principalement constituée de films grand public et de séries télévisées.
En le cherchant bien, on trouve du droit international public – car le droit international privé n’a guère eu les faveurs des cinéastes – dans nombre de films. Franck Latty montre par exemple que les règles de la lex sportiva sont un enjeu des « Chariots de feu » ou de « Rasta Rockett » – à la date du colloque, le film consacré à Lance Armstrong, « The Program », n’était pas encore sorti. Il en va de même dans les films de science-fiction, où les rapports aux extraterrestres sont en fait une allégorie des rapports entre humains – c’est le cas par exemple de « E.T. », « X-Men », « Avatar » ou « District 9 ».
Mais c’est dans les films de guerre que le droit international est logiquement le plus souvent convoqué. Les règles limitant le recours à la force – le jus ad bellum – y sont régulièrement violées. Soit qu’elles empêchent de se défendre d’une attaque : c’est l’idéalisme moqué des présidents français et américains qui négocient avec les envahisseurs dans « Mars Attacks ! ». Soit qu’elles protègent les États voyous des interventions d’humanité en réaction aux violations des droits humains dont ils se rendent coupables : c’est Rambo qui est ainsi envoyé en Birmanie au mépris de la souveraineté de cet État. Une fois la guerre déclarée, les règles qui encadrent l’usage de la force – le jus in bellum – apparaissent elles aussi comme inutilement paralysantes : dans « Zero Dark Thirty », la Central Intelligence Agency (CIA) torture impunément pour obtenir des informations permettant de traquer Oussama Ben Laden.
Pour autant, le droit international n’est pas toujours tourné en ridicule. Le jus post bellum constitue, à ce titre, un contre-exemple éclairant. Anne Lagerwall montre que « le cinéma affiche plus volontiers son soutien que sa méfiance à l’égard de la justice pénale internationale » (p. 242) – même si aucun procès pénal international n’a, jusqu’à présent, été encore porté à l’écran, à la seule exception du procès de Nuremberg.
Le sujet de ce livre peut sembler frivole. On pourrait se moquer du plaisir que ce synode de doctes juristes a probablement pris à discuter de l’application de la Charte des Nations unies dans « Bernard et Bianca » et de la Convention de Genève dans « Le Pont de la rivière Kwaï ». Cette ironie facile sous-estime l’audience de ces films, qui reflètent la conception que se fait l’opinion publique du droit international autant qu’ils la façonnent. Les États-Unis ne l’ignorent pas, et Hollywood, le Pentagone et la Maison-Blanche entretiennent depuis longtemps des relations incestueuses.