See English version below « Ça s’est passé comme ça ». Ceci...
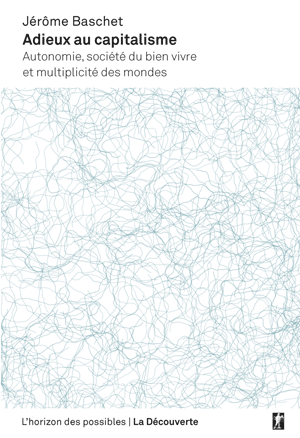
Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes
par Jérôme Baschet - Paris, La Découverte, 2014, 195p.
Jérôme Baschet, historien qui partage son enseignement entre la France et le Mexique, est également spécialiste de la rébellion zapatiste des provinces du Chiapas, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Dans une certaine mesure, on peut considérer qu’Adieux au capitalisme l’est également. En effet, l’auteur emploie l’exemple zapatiste – et de l’action menée par les hommes, femmes et enfants auxquels il dédie d’ailleurs son livre – comme le socle d’une réflexion sur la nécessité, la possibilité et les suites de l’abandon de ce modèle économique à fortes implications politiques et sociales aujourd’hui dominant dans les pays dits occidentaux.
Le constat de départ est sans appel : « nous sommes englués dans la réalité » (p. 7). Celle du capitalisme, auquel la majeure partie de la population adhère, sans doute moins par assentiment total que par peur ou impression qu’il n’existe aucune alternative à ce système qui témoigne de capacités d’adaptation et de renouvellement certaines, en dépit de limites flagrantes. Ainsi, l’analyse des logiques économiques, que l’on regroupe par soucis de simplification et d’identification, sous le terme de « capitalisme » révèle toute l’absurdité et le caractère insoutenable de ce modèle. Produire pour faire du profit, travailler pour consommer et ne pas se trouver marginalisé, progresser et innover pour faire mieux que son voisin sont autant d’impératifs qui conduisent le système à l’autodestruction : la productivité augmentant, la production de biens nécessite des travailleurs-consommateurs de moins en moins nombreux et, surtout, la production pour la production se fait au détriment des ressources naturelles pourtant indispensables à la survie de l’espèce humaine. Pourtant, ce modèle est parfaitement intégré dans chacun de nos raisonnements : il a façonné nos subjectivités. Il convient donc de réagir avant que plus personne ne se rende compte que nous courons à notre perte.
Que faire face à cette machine trop bien huilée ? C’est à cette étape du raisonnement, une fois que la nécessité de se défaire totalement du capitalisme et du « capitulisme » (p. 10) a été démontrée, que l’auteur évoque l’exemple des sociétés autonomes du Chiapas. Si cette expérience reste territorialement restreinte et ne saurait être généralisée stricto sensu, elle témoigne de la capacité des peuples à réformer les modèles politico-économico-sociaux – car tout est lié – et à s’autogouverner. De plus, cet exemple permet de percevoir les multiples avantages des « sociétés du faire [et surtout] du bien vivre » : élaboration commune et véritablement démocratique des décisions, temps de travail réduit au minimum nécessaire au fonctionnement économique et politique de la collectivité, avènement du loisir, du partage et du vivre ensemble, souci de l’autre et de l’environnement, etc. Le chemin vers ces sociétés post-capitalistes et vers une gouvernance économique et politique mondiale renouvelée passe par la défense et l’extension des « espaces protégés » déjà existants – tels que les relations amoureuses –, par la poursuite des mouvements de contestation et initiatives locales, par le dialogue entre communautés aux expériences diverses mais de même valeur, etc. C’est-à-dire par un ensemble de processus permettant l’exploitation des failles du capitalisme et préparant la grande révolution. « Nous sommes déjà en chemin » (p. 151), mais il reste encore beaucoup à faire.
Si le raisonnement peut souffrir de répétitions, de la complexité de certaines tournures ainsi que de l’utopisme de certaines situations et propositions, il n’en demeure pas moins complet et bien exemplifié. L’ouvrage réussit à mener le lecteur à s’interroger sur la vaste question de la vraie nature du modèle capitaliste et de l’avenir des sociétés régies, pour l’instant, par lui.
Le constat de départ est sans appel : « nous sommes englués dans la réalité » (p. 7). Celle du capitalisme, auquel la majeure partie de la population adhère, sans doute moins par assentiment total que par peur ou impression qu’il n’existe aucune alternative à ce système qui témoigne de capacités d’adaptation et de renouvellement certaines, en dépit de limites flagrantes. Ainsi, l’analyse des logiques économiques, que l’on regroupe par soucis de simplification et d’identification, sous le terme de « capitalisme » révèle toute l’absurdité et le caractère insoutenable de ce modèle. Produire pour faire du profit, travailler pour consommer et ne pas se trouver marginalisé, progresser et innover pour faire mieux que son voisin sont autant d’impératifs qui conduisent le système à l’autodestruction : la productivité augmentant, la production de biens nécessite des travailleurs-consommateurs de moins en moins nombreux et, surtout, la production pour la production se fait au détriment des ressources naturelles pourtant indispensables à la survie de l’espèce humaine. Pourtant, ce modèle est parfaitement intégré dans chacun de nos raisonnements : il a façonné nos subjectivités. Il convient donc de réagir avant que plus personne ne se rende compte que nous courons à notre perte.
Que faire face à cette machine trop bien huilée ? C’est à cette étape du raisonnement, une fois que la nécessité de se défaire totalement du capitalisme et du « capitulisme » (p. 10) a été démontrée, que l’auteur évoque l’exemple des sociétés autonomes du Chiapas. Si cette expérience reste territorialement restreinte et ne saurait être généralisée stricto sensu, elle témoigne de la capacité des peuples à réformer les modèles politico-économico-sociaux – car tout est lié – et à s’autogouverner. De plus, cet exemple permet de percevoir les multiples avantages des « sociétés du faire [et surtout] du bien vivre » : élaboration commune et véritablement démocratique des décisions, temps de travail réduit au minimum nécessaire au fonctionnement économique et politique de la collectivité, avènement du loisir, du partage et du vivre ensemble, souci de l’autre et de l’environnement, etc. Le chemin vers ces sociétés post-capitalistes et vers une gouvernance économique et politique mondiale renouvelée passe par la défense et l’extension des « espaces protégés » déjà existants – tels que les relations amoureuses –, par la poursuite des mouvements de contestation et initiatives locales, par le dialogue entre communautés aux expériences diverses mais de même valeur, etc. C’est-à-dire par un ensemble de processus permettant l’exploitation des failles du capitalisme et préparant la grande révolution. « Nous sommes déjà en chemin » (p. 151), mais il reste encore beaucoup à faire.
Si le raisonnement peut souffrir de répétitions, de la complexité de certaines tournures ainsi que de l’utopisme de certaines situations et propositions, il n’en demeure pas moins complet et bien exemplifié. L’ouvrage réussit à mener le lecteur à s’interroger sur la vaste question de la vraie nature du modèle capitaliste et de l’avenir des sociétés régies, pour l’instant, par lui.