19.12.2024
La situation internationale ouverte par la guerre en Ukraine : se parer des raisonnements binaires et du prêt à penser idéologique
Tribune
5 avril 2022
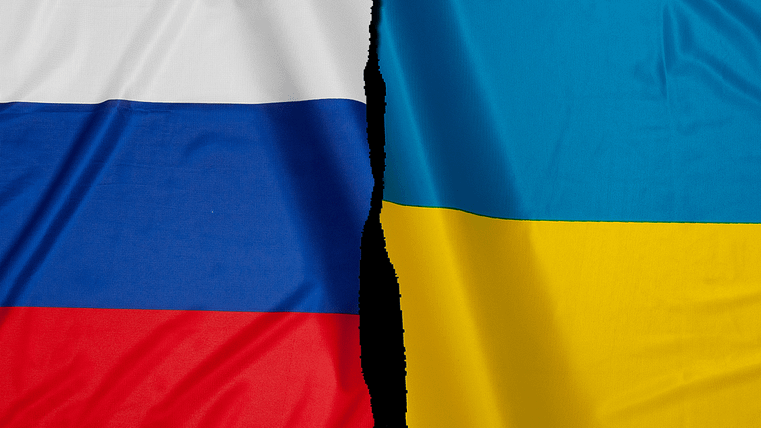
La guerre en Ukraine induit de multiples conséquences sur les rapports de force géopolitiques internationaux, mais l’inflation des commentaires sur l’actualité immédiate rend malaisée la prise de recul nécessaire pour tenter de se projeter vers l’avenir. Il est néanmoins loisible de formuler quelques observations dont les effets marqueront sans nul doute les années futures.
Compte tenu de la localisation géographique du conflit en cours, il apparaît dans un premier temps naturel de le considérer à travers un prisme européen. Il faut toutefois admettre que l’exercice est alors pour le moins réducteur. L’état de stupéfaction de toutes les capitales européennes devant l’agression russe est largement compréhensible – bien peu nombreux sont en effet les analystes qui avaient prévu cette éventualité – mais, contrairement à ce qui a souvent été répété, ne peut néanmoins s’expliquer par le fait que ce conflit serait le premier qui ensanglante le Vieux Continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les guerres balkaniques des années 1990 ne sont pas si lointaines qu’elles puissent être occultées de manière si désinvolte. Les soixante-dix-huit jours de bombardements de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) contre la Yougoslavie en 1999, sans aucun mandat de l’Organisation des Nations unies (ONU) faut-il le rappeler, sont bien vite occultés, ce qui relève, a minima, d’une mémoire pour le moins sélective. Mais l’essentiel n’est pas là.
La rapidité et l’ampleur des sanctions adoptées à l’encontre de la Russie ont été largement saluées. Soit. Nous verrons si elles montrent leur efficience. Mais soyons surtout conscients qu’elles sont à cette heure pour l’essentiel mises en œuvre par les puissances occidentales et refusées par le reste du monde. Le vote de l’Assemblée générale de l’ONU, le 2 mars 2022, est de ce point de vue très significatif. Certes une très forte majorité d’États condamnent l’agression russe – 141 sur 193 –, mais 35 s’abstiennent et 12 ne prennent pas part au vote, la plupart africains – pas moins de 17 abstentions – ou asiatiques. Plus nombreux encore sont ceux qui refusent de s’associer aux sanctions, y compris certains traditionnellement proches des capitales occidentales, et tout particulièrement de Washington. Pour autant nulle allégeance à Vladimir Poutine, mais bien plutôt défiance à l’égard des puissances occidentales.
Nous savons ainsi le pas de deux des Émirats arabes unis, qui s’abstiennent lors du vote de condamnation de la Russie par le Conseil de sécurité, mais votent celle-ci à l’Assemblée générale de l’ONU, parce que non contraignante dans cette dernière instance. L’Arabie saoudite, pour sa part, refuse de souscrire aux pressantes demandes des États-Unis d’augmenter sa production de pétrole pour juguler l’envolée des cours de l’or noir. Ces deux États, dont les liens avec Washington se sont distendus au cours des récentes années, ne veulent avant tout pas se froisser avec la Russie, voire avec la Chine, l’une et l’autre de plus en plus présentes au Moyen-Orient. Ces formes de résistance s’inscrivent, en outre, dans un contexte de réticence grandissante à l’égard de la façon dont l’administration Biden gère les questions sécuritaires dans le Golfe.
La Turquie, membre de l’OTAN, qui a sans ambiguïté condamné l’agression de la Russie, refuse, elle aussi, d’endosser les sanctions, expliquant qu’elle n’appliquerait que celles qui seraient votées par l’ONU, et choisit de prendre plusieurs initiatives de médiation entre Moscou et Kyiv, indiquant qu’elle entend du même coup se positionner au centre du jeu diplomatique en jouant sa propre partition. Fortement vilipendé ces dernières années par de nombreux membres de l’Alliance, Recep Tayyip Erdogan fut largement courtisé, souvent par les mêmes, lors du sommet de l’OTAN du 24 mars.
L’Inde a, pour sa part, reçu le ministre russe des Affaires étrangères en grande pompe les 31 mars et 1er avril pour conforter la neutralité de New Delhi, confirmer les commandes de pétrole russe et négocier des achats d’armements. Il s’agit clairement d’un défi majeur pour les États-Unis, tout à leur préoccupation d’endiguer la Chine, notamment dans la zone indopacifique. Ainsi ces deux géants asiatiques, représentant la bagatelle 2,5 milliards d’individus, refusent-ils, pour des raisons différentes, de faire allégeance aux décisions occidentales.
Il serait bien inconséquent de ne pas savoir tirer les leçons de ces quelques observations, au demeurant loin d’être exhaustives. Nous avons sous les yeux une nouvelle preuve que ceux que l’on appelle parfois rapidement les pays « émergents »[1] affirment et revendiquent l’indépendance de leurs choix politiques face aux exigences des puissances occidentales. Ces dernières ont visiblement beaucoup de peine à comprendre et admettre ce récent paramètre des relations internationales : tous les États sont désormais majeurs, politiquement actifs et n’acceptent plus de se voir dicter leurs décisions.
Au demeurant, pour nombre de ces pays, la guerre n’est malheureusement pas une situation exceptionnelle, et il existe un fort sentiment d’injustice face aux indignations sélectives et au « deux poids, deux mesures » couramment pratiqué par les dirigeants occidentaux. Les Palestiniens peuvent, à juste titre, être révoltés que la non-application du droit international sur leur territoire ne suscite que bien peu de réactions, et encore moins d’initiatives concrètes, pour faire appliquer les décisions de l’ONU. Les Yéménites, quant à eux, peuvent faire le même douloureux constat, sans parler des Irakiens dont, d’après un article de la revue médicale britannique The Lancet paru en 2006, 600 000 sont morts dans le cours de la guerre décidée unilatéralement par les États-Unis en 2003.
Il est, dans ce contexte, frappant de constater le peu de réactions de l’ONU. On sait cette organisation lourde et peu mobile, mais l’inexistence politique de son secrétaire général, António Guterres, au cours des dernières semaines est pour le moins déroutante : aucune démarche concrète auprès des protagonistes principaux de la guerre, aucune proposition significative formulée par une organisation censée incarner le multilatéralisme et assurer la régulation des relations internationales. Le constat d’échec est préoccupant.
A contrario, les États-Unis ont saisi l’opportunité qui se présentait à eux en tentant de radicaliser davantage encore les positions. Joe Biden, traitant Vladimir Poutine de « boucher » et considérant qu’il ne « pouvait pas rester au pouvoir » après l’invasion de l’Ukraine, se place dans une logique de guerre froide et de changement de régime. Il n’a pas été suivi sur ce point par la plupart des dirigeants européens. Nous y reviendrons. L’agression de la Russie à l’encontre de l’Ukraine fournit à Washington l’opportunité d’avancer résolument dans la concrétisation de son projet d’organiser le bloc des démocraties contre les régimes qualifiés, souvent à juste titre, d’autoritaires. M. Biden, dans une logique états-unienne classiquement binaire, veut souder le « monde occidental » derrière lui pour affronter les rivaux systémiques que sont à ses yeux la Russie et la Chine. Les Européens devraient se parer d’une telle politique, car leurs intérêts ne sont pas en la matière les mêmes que ceux de Washington.
On peut entendre nombre de responsables européens se féliciter des réactions puissantes et unies qu’ils ont su opposer à Vladimir Poutine. Certes, mais cela n’évacue pas le fait que l’OTAN – malencontreusement considérée par certains en état de mort cérébrale il y a à peine plus de deux ans – est de retour et apparaît comme l’axe autour duquel s’organise la riposte nécessaire à la Russie. L’Allemagne décide de créer un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour équiper l’armée fédérale – décision d’une importance capitale si l’on considère les soixante-dix dernières années de l’histoire de l’Allemagne – et annonce dans le même temps l’achat de F35 et d’avions furtifs de fabrication états-unienne, ce qui ne va guère dans le sens de la construction de l’Europe de la défense qui, comme la ligne d’horizon pour les marins, s’éloigne au fur et à mesure que l’on avance. La Suède et la Finlande s’interrogent, pour leur part, sur leur hypothétique adhésion à l’OTAN. C’est donc à l’« otanisation » de l’Europe à laquelle nous assistons en ces jours sombres.
Enfin, il est frappant que les grilles d’analyse les plus fréquemment produites soient occidentalocentrées sans véritablement prendre la mesure des réactions dans les autres parties de la planète. Or nous nous trouvons présentement dans un monde apolaire qui se doit d’accoucher de formes de régulation multilatérales. La France a eu raison de condamner sans appel la guerre d’agression dont la responsabilité incombe totalement au maître du Kremlin, mais son intérêt n’est de s’aligner sur quiconque : il est, au contraire, de résister à la tentative de réorganiser le monde dans la logique d’un nouveau duopole, d’une guerre froide du XXIe siècle. La guerre froide du XXe siècle signifiait l’affrontement de deux blocs politiquement, économiquement, militairement, culturellement, idéologiquement opposés, qui prétendaient incarner des projets de société radicalement différents. Nous ne sommes plus aujourd’hui dans la même situation, mais dans le cadre de concurrences interimpérialistes acharnées qui peuvent prendre la forme de guerres, comme celle déclarée par Vladimir Poutine.
C’est de la responsabilité de la France de renouer les contacts avec tous les pays, et ils sont nombreux, qui possèdent une approche similaire des relations internationales. Il est plus que jamais nécessaire de décentrer nos regards pour comprendre que les grilles d’analyse antérieures ne sont plus efficientes. Il s’agit d’en inventer de nouvelles.
_____________________
[1] Sur ces États dits « émergents » et la relativité de cette notion, lire par exemple le dossier « Émergence(s) », La Revue internationale et stratégique, n° 103, IRIS Éditions – Armand Colin, automne 2016.