13.12.2024
Décès du Président du Burundi : comment le pays se prépare-t-il à l’après-Nkurunziza ?
Tribune
16 juin 2020
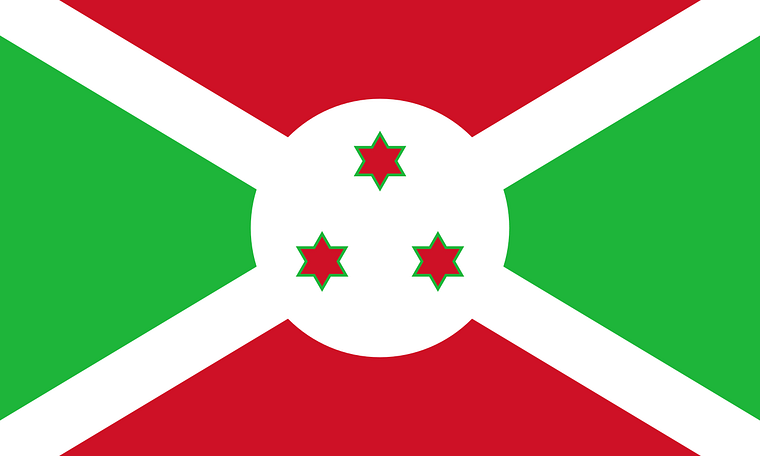
« Les gens ont peur, avoue un militant de l’opposition. Le gouvernement a intimé aux gens de rentrer chez eux et des policiers et des militaires ont été déployés dans la ville pour assurer la sécurité », poursuit-il. Quelques heures après l’annonce du décès du Président Pierre Nkurunziza, ce 8 juin 2020, l’ambiance à Bujumbura est plutôt tendue. Le déploiement de soldats et policiers dans la ville s’est probablement imposé afin de prévenir toute forme de réaction populaire. D’après des sources journalistiques, des personnes seraient arrêtées dans les bistrots, accusées de « célébrer la mort du président ». Étrangement, peu de commentaires circulent sur les réseaux sociaux, alors que dans l’après-midi du mardi 9 juin, les principaux médias français et burundais relayaient la nouvelle du décès du président, officiellement à cause d’un arrêt cardiaque, mais plus probablement des suites du Covid-19. Son épouse, Denise Nkurunziza ainsi que trois gardes du corps ont été hospitalisés pendant plusieurs jours à Nairobi. Ils avaient été évacués par un avion de l’Association pour la médecine et la recherche en Afrique (AMREF), et pris en charge dans un hôpital privé, d’où des soupçons de propagation du Covid-19 jusqu’au cercle du pouvoir, voire au-delà.
La nouvelle de la mort de Nkurunziza prend à l’improviste le monde politique burundais suscitant des sentiments contrastés : si certains se réjouissent de la disparition d’un despote, plusieurs s’inquiètent pour l’avenir proche du pays. À quels scénarios s’attendre dans l’après-Nkurunziza ? Le décès du Président intervient dans une période très délicate pour un pays à la stabilité précaire. Le 20 mai ont eu lieu les élections nationales (législatives, communales et présidentielles)[1], qui ont donné la victoire au Conseil national de défense de la démocratie -F orces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), le parti au pouvoir depuis 2005. Début juin, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a validé la victoire à la présidentielle d’Evariste Ndayishimiye, considéré comme le dauphin de Nkurunziza. Ce dernier, qui aurait dû passer le témoin à son successeur le 20 août, avait bien préparé ses arrières avant l’annonce officielle de la candidature de Ndayishimiye à la présidence, afin de s’assurer la gestion du pouvoir politique malgré l’apparente alternance au sommet. Ainsi, en janvier 2020, l’Assemblée nationale avait adopté un projet de loi élevant au rang de « guide suprême du patriotisme » le président Pierre Nkurunziza. À ce titre, il aurait été consulté « sur des questions relatives à la sauvegarde de l’indépendance nationale, à la consolidation du patriotisme et à l’unité nationale ». De plus, il aurait bénéficié de très nombreux avantages à la fin de son mandat : une villa de haut standing, une allocation de 500 000 euros et une indemnité égale aux émoluments d’un député pour le reste de sa vie.
La mort « inopinée » du « guide suprême du pays » libère, d’une certaine manière, le futur président nouvellement élu d’une tutelle qui aurait pu se révéler peu confortable. Cela pourrait cependant également fragiliser son pouvoir en cas de conflits pour le leadership à l’intérieur du parti. Privé de son « père spirituel », de quels soutiens bénéficiera-t-il ? Qui prendra le leadership de cet ancien mouvement armé qu’est le CNDD-FDD ? C’est le dilemme de tout mouvement politique qui fonde son existence sur le culte de la personnalité. Jusqu’à présent, tous ceux qui avaient osé remettre en question le leadership de Nkurunziza avaient été arrêtés, tués ou obligés de quitter le pays. Le noyau dur du CNDD-FDD s’était montré solide autour de la figure du président qui avait su éviter l’effritement du parti et gérer les rivalités internes. Son décès engendre, donc, beaucoup d’incertitudes, plusieurs poids lourds du parti pouvant se disputer le rôle de « guide suprême ». Cela signifie que la légitimité de Ndayishimiye pourrait ne pas être reconnue par les différentes factions qui composent le mouvement. Considéré comme un homme de dialogue, beaucoup moins intransigeant que Nkurunziza, la candidature de Ndayishimiye avait ravivé l’espoir d’une possible ouverture du parti, à la fois vis-à-vis de l’opposition en exil et de la communauté internationale. Une éventuelle lutte interne pour le leadership pourrait déstabiliser encore plus un système déjà fragile ou, au contraire, pourrait profiter à l’opposition, pouvant se saisir de l’occasion pour reprendre son rôle à l’intérieur du pays et se renforcer. En cette période, aucun scénario n’est à exclure. Les leaders politiques de l’opposition hésitent aussi à s’exprimer pour le moment, témoignant de l’incertitude qui règne dans le pays.
Dans l’immédiat, la question à laquelle devait faire face le parti au pouvoir était soit de désigner un président par intérim d’ici la proclamation officielle du nouveau président prévue en août, soit une désignation anticipée de Ndayishimiye. C’est la seconde option qui a été privilégiée, le nouveau président du Burundi devant prêter serment ce jeudi 18 juin.
Nkurunziza ne s’était pas montré arrangeant à l’égard de la communauté internationale non plus, qu’il accusait « d’avoir toujours cherché à saboter son pouvoir et à déstabiliser le pays ». Depuis la crise électorale de 2015, les relations avec plusieurs pays occidentaux ainsi qu’avec certains pays de la région, notamment, le Rwanda, sont tendues. En 2015, les principaux partenaires du Burundi, dont l’Union européenne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, avaient déjà procédé au gel d’une partie de leur aide. La France a annoncé la reprise des relations diplomatiques avec le Burundi seulement en juillet 2019[2]. En 2015, la crainte que la crise burundaise puisse se généraliser dans toute la région des Grands Lacs avait poussé la communauté internationale à condamner la candidature de Nkurunziza à un troisième mandat, considéré par la plupart des observateurs comme anticonstitutionnel[3]. Depuis, le régime du CNDD-FDD a donné du fil à retordre à la communauté internationale, accusée à maintes reprises d’ingérence. En octobre 2016, en riposte à la décision de la Cour d’examiner les atteintes aux droits humains perpétrées dans le pays, le Burundi annonce son retrait de la Cour pénale internationale (CPI). Plus récemment, le 14 mai 2020, à la veille des élections nationales, quatre représentants de l’OMS ont été expulsés du Burundi, alors qu’ils mettaient en garde contre les risques de diffusion du Covid-19 pendant la campagne électorale. Le gouvernement a toujours dénié une possible propagation de l’épidémie dans le pays, assurant que Dieu purifiait l’air du Burundi et l’épargnerait de la pandémie. Pourtant, des médecins burundais avaient tiré la sonnette d’alarme avant les élections, dénonçant une politique délibérée d’occultation des cas de Covid-19, afin de ne pas perturber le déroulement des élections.
Aux craintes liées à la succession de Nkurunziza à la tête du parti, s’ajoutent, donc, celles relatives à la situation sanitaire. Des rumeurs circulent sur l’état de santé de plusieurs hautes personnalités. Il est fort probable que le virus circule à un rythme soutenu depuis un certain temps au Burundi. Si cela est le cas, la campagne électorale a sans doute joué un rôle dans la propagation de l’épidémie, car aucune mesure sanitaire ou de distanciation sociale n’a été adoptée par les autorités en place. Le risque épidémique semble ainsi plus élevé que la probabilité d’une énième vague de violence politique. Certains observateurs estiment que le pouvoir en place s’efforcera de se souder autour de la figure de Ndayishimye afin de préserver ses acquis, au lieu de se déchirer dans une lutte pour le leadership. Pourtant, il est peu probable que le parti réussisse à surmonter le vide de pouvoir laissé par Nkurunziza, sans passer par une douloureuse restructuration interne.
———————————————
[1] Trois scrutins, à savoir présidentiel, législatif et communal, se sont déroulés en même temps le 20 mai, tandis que les sénatoriales et les collinaires sont prévues pour le 20 juillet. Aucune équipe d’observateurs internationaux n’a été autorisée à superviser les élections, et les diasporas ont été interdites de voter.
[2] Alors que l’Union européenne venait de renouveler ses sanctions à l’encontre du régime de Pierre Nkurunziza, la France décidait une reprise des relations diplomatiques avec le Burundi. Ce choix n’a pas été motivé par la diplomatie française, suscitant les réactions de l’opposition burundaise en exil.
[3] Contrairement à d’autres régions sur le continent africain, l’Afrique des Grands Lacs a vu se multiplier les troisièmes mandats et les réformes constitutionnelles. Peu avant l’annonce d’une troisième candidature de Nkurunziza en 2015, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait fait de même via un référendum constitutionnel. En RDC, Kabila ne manquait pas de tester le terrain avec des déclarations laissant entendre son intention de changer la constitution afin de se présenter pour un troisième mandat, suscitant de vives protestations. Les pays occidentaux, craignant une reprise des violences politiques au niveau régional, ont alors pris position contre le troisième mandat de Nkurunziza, dans le but, entre autres, de mettre en garde les autres leaders politiques de la région.