09.01.2025
De l’IA en Amérique : les GAFAM mènent la danse stratégique
Tribune
30 janvier 2019
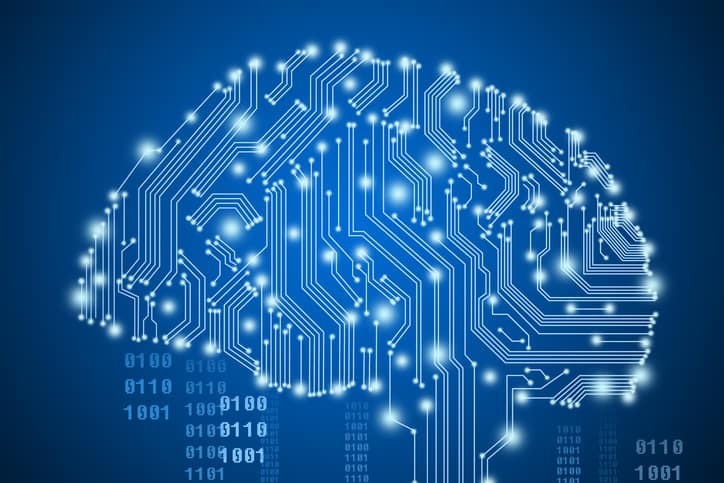
En deux ans, l’intelligence artificielle est devenue la clef de voûte des ambitions internationales chinoises. En réponse, les États-Unis ont multiplié les mesures sans véritable cohérence, avant d’établir une commission ad hoc qui fait la part belle aux géants du numérique pour fixer une stratégie. Les espoirs américains reposent désormais sur la bonne volonté de la Silicon Valley.
La guerre économique se renforce entre les deux principales puissances de ce premier XXIe siècle, saupoudrée d’accusations d’espionnage (affaire Huawei) et de tweets spasmodiques distillés par le président américain. Depuis 2017, les tensions se cristallisent progressivement autour d’un répertoire de techniques vivement convoité : l’intelligence artificielle. Depuis les années 1950, les États-Unis ont dominé sans partage ce secteur. Mais les prouesses réalisées ces dernières années grâce à la technique du machine learning, et notamment de son sous-domaine, le deep learning, ont éveillé l’intérêt d’autres États comme jamais auparavant, au premier rang desquels la Chine. Les opportunités économiques et militaires ouvertes par l’IA, les sommes faramineuses investies dans ce secteur par Pékin et ses grandes entreprises numériques (les BATX), suggèrent que les États-Unis pourraient abdiquer, sous peu, leur statut de première puissance technologique – de l’aveu même de la Commission sur la stratégie de défense nationale américaine.
Une stratégie d’entreprise(s) pour le développement de l’IA au service des États-Unis
La dernière loi budgétaire de la Défense nationale américaine (National Defense Authorization Act) a prescrit la formation d’une Commission de sécurité nationale pour l’intelligence artificielle (National Security Commission for Artificial Intelligence) censée formuler une série de recommandations auprès de l’exécutif afin de préserver l’avance des États-Unis en IA. Dotée d’un budget de 10 millions de dollars, pour une durée inférieure à deux ans, cette commission a dévoilé le nom de ses membres le 18 janvier dernier : Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google et de sa maison-mère, Alphabet, en prend la tête, assisté par Robert O. Work, ancien secrétaire adjoint à la Défense.
Le Congrès et la Maison-Blanche ont chargé cette commission de « surveiller » les investissements et les programmes étrangers en IA — notamment ceux liés à la sécurité nationale — et de formuler des recommandations, auprès des institutions publiques, pour améliorer la recherche et la formation en intelligence artificielle et examiner les risques d’utilisation de l’IA par les États-Unis ou d’autres pays. Par ailleurs, il est également demandé à la commission de soumettre des recommandations éthiques et opérationnelles afin d’encadrer l’application de l’apprentissage automatique (machine learning) au secteur de la défense. Enfin, sa dernière tâche sera d’envisager une normalisation et une standardisation des données dans la sphère de la sécurité nationale, indispensables pour améliorer leur traitement par des systèmes d’intelligence artificielle.
Cette commission devra donc établir la feuille de route du gouvernement américain, censée lui permettre de sauvegarder sa prépondérance techno-militaire. Fait intéressant, les principales figures de cette commission sont de grands noms de l’industrie numérique : Eric Schmidt, bien entendu, mais aussi Safra Catz, PDG d’Oracle, Eric Horowitz, directeur de Microsoft Research, Andy Jassy, PDG d’AWS, la filiale d’Amazon spécialisée dans le cloud computing, et Andrew Moore, responsable scientifique de Google Cloud. Certes, l’industrie américaine a toujours été associée, de près ou de loin, à la politique gouvernementale américaine. Mais l’originalité de cette commission est qu’elle implique des cadres dirigeants de la Silicon Valley, expressément sélectionnés pour définir des orientations stratégiques majeures. Il ne s’agit pas d’entretiens ou de simples réunions avec des industriels du numérique qui alimenteront, comme par le passé, la réflexion des décideurs politiques et du personnel de l’administration. Il est question d’impliquer activement — et officiellement — le secteur privé dans la formulation d’une stratégie d’État.
Les représentants de ces entreprises entretiennent des liens particulièrement étroits avec l’administration américaine, si bien que leur place dans cette commission, leur rôle et leurs motivations interrogent. Depuis mars 2016, Eric Schmidt préside le Defense Innovation Advisory Board, un organe consultatif du Pentagone dont l’objectif avoué est d’accélérer les transferts d’innovations technologiques et managériales/organisationnelles des firmes numériques de la Silicon Valley vers le Département de la Défense. En 2017, il participa au lancement du Projet Maven, mis en place par… Bob Work, son coprésident à la commission stratégique sur l’IA. Sans que jamais la question d’un possible conflit d’intérêts n’effleurât la presse américaine, Google — dont Schmidt dirigeait alors la maison-mère — fut directement associé au projet pour fournir aux drones de l’armée américaine des systèmes de reconnaissance d’image. Schmidt ne quitterait la présidence d’Alphabet, d’ailleurs, que début 2018, tout en restant au conseil d’administration et en exerçant des fonctions de conseiller technique sur la science et la technologie.
Schmidt n’est pas le seul à occuper cette position équivoque d’intermédiaire, de « go-between », entre l’industrie numérique et l’État. Le cas de Safra Catz, d’une certaine manière, présente certaines analogies : sans exercer de fonction officielle au sein de l’appareil d’État, la PDG d’Oracle, proche de Donald Trump, a néanmoins été pressentie au poste de directrice du renseignement national, et Oracle est un partenaire de longue date du Pentagone. La même analyse pourrait être appliquée à l’ensemble des cadres dirigeants d’entreprises numériques qui ont été nommés à la commission, et le résultat serait identique : la frontière entre les GAFAM et l’État est particulièrement poreuse, les liens interorganisationnels et interpersonnels qui unissent ces deux mondes concourent à la structuration d’un « complexe techno-étatique », technocratique, même, au sens quasi étymologique du terme. Les raisons de cette coalescence sont nombreuses : elles reposent sur des cercles de sociabilité communs (réseaux d’anciens étudiants de grandes universités, fondations, clubs), des communautés idéologiques homologues (néolibéraux, libertariens, objectivistes, transhumanistes) et des pratiques de lobbying et de revolving doors finement organisées par les multinationales. Pour prendre l’exemple de Google, entre 2005 et 2016, l’entreprise a embauché près de 200 membres du gouvernement américain, dont une majorité à des postes de lobbyistes, et, concomitamment, une soixantaine de ses employés ont rejoint la Maison-Blanche, les agences gouvernementales ou le Congrès. Entre 2015 et 2018, Alphabet a déboursé près de 70 millions de dollars en lobbying à Washington : 82 % de ses lobbyistes enregistrés sur la période 2017-2018 travaillaient auparavant soit à la Maison-Blanche, soit dans des agences gouvernementales, soit au Congrès.
La confrontation de deux modèles… idéologiques ?
Américains et Chinois ont deux façons nettement différentes de concevoir le développement de l’intelligence artificielle et, plus généralement, les politiques technologiques. Pour la résumer en un mot, la conception américaine repose sur un modèle néolibéral. Les États-Unis n’ont pas de véritable stratégie en matière de développement de l’IA : leur dépendance accrue, ces dernières années, à l’égard des multinationales du numérique a entamé leur capacité à établir un programme cohérent, structuré, autour du développement des nouvelles technologies. Leur marge de manœuvre se réduit à de simples mécanismes incitatifs, qui se matérialisent par des contrats juteux avec le Pentagone ou par l’instauration d’exemptions fiscales, pour incliner ces grandes entreprises à poursuivre leur collaboration avec le gouvernement américain. Cela n’empêche en rien ces firmes de contrevenir aux intérêts nationaux américains. En décembre 2017, Google a ouvert un centre de recherche en intelligence artificielle à Pékin et collabore, désormais, avec la communauté des ingénieurs chinois notamment pour les former. Or, les relations sino-américaines ne cessent parallèlement de se dégrader, les tensions s’accentuent avec, pour toile de fond, la crainte de voir la Chine remporter la bataille de l’innovation technologique et se subroger aux États-Unis au rang de première puissance. L’autonomie stratégique des GAFAM à l’égard des États-Unis est loin d’être acquise, mais les premiers signes d’émancipations sont là.
À l’inverse, la Chine mène une politique dirigiste et interventionniste auprès de son tissu industriel et académique. En juillet 2017, c’est le Conseil des affaires de l’État qui dévoile le « Plan national de développement de la prochaine génération d’intelligence artificielle ». C’est encore lui qui annonce le financement de ce plan à hauteur de 22 milliards de dollars par an, puis 60 milliards dollars d’ici 2025. La conjonction des efforts de l’État, du Parti communiste et, finalement, de l’Armée populaire de libération, d’un côté, et des firmes technologiques, de l’autre, s’est résolument approfondie depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2012. Une stratégie que le président chinois a même baptisée du nom de « fusion civilo-militaire ». Déjà, en 2015, l’expression figurait dans le plan « Made in China 2025 ». En janvier 2017, Xi Jinping a lui-même mis sur pied la Commission de développement de la fusion civilo-militaire du Parti communiste, et ce modèle a immédiatement été transposé au développement de l’intelligence artificielle. La mise en œuvre de cette stratégie est coordonnée par le Parti communiste, qui impose les grands axes stratégiques de développement aux grandes entreprises technologiques chinoises (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, etc. – les « BAT[H]X »), afin qu’elles innovent et conçoivent des technologies duales, à double usage, tant civil ou commercial que militaire. Cette subordination partidaire de l’innovation civile et militaire, particulièrement significative dans le domaine de l’intelligence artificielle, s’est d’autant plus naturellement installée que les cadres dirigeants des grandes firmes technologiques chinoises sont tous des membres haut placés du PCC. Au total, la stratégie de développement chinoise en IA s’articule autour de ce que nous appelons un « complexe partidaire-entrepreneurial », pierre angulaire du capitalisme d’État totalitaire.
Deux modèles de développement, deux idéologies s’affrontent ainsi sur le champ de bataille de l’intelligence artificielle. Depuis 1945, les États-Unis ont nourri leur avance technologique pour asseoir, progressivement, leur prépondérance puis leur hégémonie sur le reste du monde. Pour ce faire, ils pouvaient s’appuyer sur un appareil d’État dirigiste, bien plus intrusif dans l’économie et la recherche nationales que ce que prétendait alors l’homélie libérale. Internet n’aurait peut-être jamais vu le jour sans ARPANET, le premier réseau à transferts de paquets développé au tournant des années 1960-1970 par l’Advanced Research Projects Agency (ARPA), l’ancêtre de la DARPA. Point d’interface graphique, de lien hypertexte et, donc, de Web non plus, sans le financement de la NASA, de l’ARPA, et sans l’US Air Force, pour laquelle Douglas Engelbart propose en 1961 l’oN-Line System. Songeons que, dès 1963, l’ARPA commença à financer la recherche du MIT en intelligence artificielle à hauteur de 2,2 millions de dollars de l’époque par an ! Aujourd’hui, les investissements publics dans la recherche américaine demeurent, mais ils sont dépassés — et de loin — par les investissements privés de firmes que l’État lui-même a contribué à faire naître et prospérer. Il est signifiant que l’architectonique technologique soit passée des mains du secteur public au secteur privé, du militaire au civil : la naissance de l’État moderne avait été inaugurée par la monopolisation de la production technique à visée militaire ; l’État postmoderne, quant à lui, né du tournant néolibéral des années 1970-1980, s’illustre par son désengagement, l’automutilation de ses capacités d’initiative et d’organisation des politiques technologiques sur lesquels, désormais, « les industriels ont la main »[1]. Récemment encore, le « noyau régalien » militaro-policier de l’État semblait échapper à ce mouvement. Mais la mise sur pied de cette Commission de la sécurité nationale pour l’intelligence artificielle vient profaner l’un des derniers sanctuaires du monopole d’État : le choix souverain des grandes orientations stratégiques de la nation.
À l’inverse, la Chine prend modèle sur l’ancien schéma occidental de l’« administration technicienne » qui fit, jadis, le « succès » de l’Europe et des États-Unis. L’héritage confucéen, remanié pendant deux millénaires par les régimes successifs, y compris le régime communiste et ses évolutions contemporaines, a permis l’émergence d’un appareil d’État d’une redoutable efficacité. La crainte, voire pour certains, la terreur qu’inspire la montée en puissance chinoise ressortit pour une large part à cette réappropriation d’un « modèle occidental » en déshérence. C’est ici que la comparaison entre les GAFAM et les BATX s’achève : tandis que les uns suppléent l’État au point de s’y substituer en partie, les autres s’y soumettent et placent leurs compétences à son service.
————————————————-
[1] Pierre Musso, « De la technologie d’État à l’État technologisé ? L’État et les technologies en France », RIS, n°110, été 2018, p. 70.