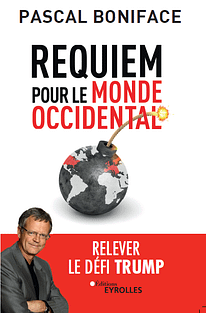13.12.2024
« Trump, syndic de faillite de l’hégémonie libérale ? » (3/5) – L’unanimisme idéologique des think tanks américains
Édito
21 janvier 2019

A l’occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d’articles d’analyse portant sur l’hégémonie libérale et la politique extérieure de Donald Trump.
Stephen Walt est à la fois un universitaire américain majeur, spécialiste des affaires stratégiques, tout en étant relativement à la marge de la communauté stratégique américaine. Il ne partage pas le consensus qui, selon lui, règne dans la galaxie des experts stratégiques au-delà des différences apparentes qui opposent conservateurs et libéraux. Tous sont en fait partisans du concept « d’hégémonie libérale » qui caractérise la politique extérieure américaine depuis la fin de la guerre froide. Le dernier livre de Stephen Walt « The hell of good intentions » est un pilonnage en règle, minutieusement argumenté et solidement documenté, de cette stratégie. Il est dérangeant pour ceux qui sont les faiseurs d’opinion dans le domaine stratégique aux États-Unis, et ne devrait donc pas recevoir un accueil chaleureux.
Pour Walt, la stratégie d’hégémonie libérale suivie par toutes les administrations américaines depuis la fin de la guerre froide a été une faillite coûteuse. Clinton, Bush, Obama, au-delà de leurs divergences, ont en réalité poursuivi une politique assez comparable dans son essence fondamentale. Mais Walt ne tombe pas dans les thèses complotistes qui parfois fustigent la politique étrangère américaine en renforçant, par leurs fantasmes délirants, les « raisonnables » qui la soutiennent. La stratégie d’hégémonie libérale n’est pas, selon lui, le fruit d’un complot de quelques privilégiés à la recherche d’un avantage personnel, mais le résultat d’une politique menée par des individus sincèrement convaincus que la domination des États-Unis sur le monde est bonne aussi bien pour le premier que pour le second. Mais pas plus que les banquiers qui ont été à l’origine de la crise financière de 2008, ceux qui ont déterminé la politique étrangère américaine n’ont été mis en cause pour les erreurs catastrophiques qu’ils ont pu provoquer.
Il n’est dès lors par étonnant, selon Walt, qu’un candidat inexpérimenté, qui remettait ouvertement en cause la politique étrangère de son pays, et dont les positions étaient condamnées par l’establishment stratégique, soit entré à la Maison-Blanche. Les experts en politique étrangère de tout bord ont collectivement dénoncé les dangers que faisait peser Trump sur la diplomatie américaine. Pratiquement aucun expert ayant pignon sur rue ne l’a soutenu. Mais loin de disqualifier Trump aux yeux d’une grande partie des Américains, ceci a plutôt renforcé la confiance qu’ils lui accordent. Lorsque des spécialistes républicains ont signé une lettre mettant en doute la maîtrise des dossiers et le tempérament de Donald Trump, celui-ci a répondu que les signataires étaient eux-mêmes responsables des désordres mondiaux actuels. Walt, s’appuyant sur de nombreuses enquêtes d’opinion, rappelle que l’opinion publique est nettement moins favorable que les milieux d’experts à une politique extérieure interventionniste. Et c’est pour cela que Donald Trump a acquis, y compris dans ce domaine, une popularité en s’opposant aux experts. Qui peut en effet estimer que les États-Unis bénéficient de plus d’appuis, de poids ou de sécurité qu’en 1990 ? Les politiques conçues et suivies n’ont en rien amélioré la situation des États-Unis, et une grande partie du public n’est pas dupe.
Pour Walt, l’élite que représentent les experts stratégiques est une caste dysfonctionnante, faite de privilégiés qui généralement dédaignent les perspectives alternatives et sont immunisés à la fois professionnellement et personnellement des conséquences des politiques qu’ils ont mis en œuvre. Parmi les reproches faits à la profession transparait celui de l’endogamie du marché de l’emploi en affaires étrangères et de la nécessité de demeurer dans un consensus respectable pour percer dans ce domaine.
Au-delà des différences mineures, libéraux et néo-conservateurs défendent la stratégie d’hégémonie libérale et sont convaincus que les États-Unis peuvent poursuivre cette ambitieuse stratégie sans déclencher de sérieuse opposition.
La puissance militaire des États-Unis les conduit à privilégier l’approche militaire sur l’approche diplomatique. Mais pour Walt, ce n’est pas ainsi qu’on lutte contre le terrorisme, que l’on crée une culture politique ou que l’on bâtit une société.
L’échec a donc été patent en Afghanistan, en Bosnie, en Irak, au Kosovo, en Libye, en Somalie et au Yémen. Toutes les interventions dans ces pays, absolument toutes, ont été des échecs. La diplomatie basée sur la menace, les altercations et le refus des compromis produit rarement des succès.
C’est donc à une critique en règle des milieux de l’expertise stratégique à laquelle Walt se livre. S’il ne remet pas en cause le patriotisme des experts, il souligne la tendance à multiplier les appels à une politique extérieure active et interventionniste. Cela a d’ailleurs pour conséquence de favoriser le marché de l’expertise stratégique et d’autocréer des débouchés professionnels. « L’hégémonie libérale et l’activisme global incessant constituent une stratégie de plein-emploi pour la communauté stratégique de politique étrangère », écrit Walt. Le personnel du Conseil national de sécurité est passé d’une vingtaine de personnes en 1960 à environ 200 sous George W Bush et à 400 sous la présidence d’Obama. Le département de la Défense emploie 700 000 personnes et la communauté du renseignement, dont le budget est de 50 milliards de dollars, emploie 100 000 personnes. Il y a donc selon lui une forte incitation au conformisme. Il est préférable d’avoir tort en bonne compagnie que raison de façon solitaire. Walter Lippmann disait déjà : « Quand tout le monde pense la même chose, personne ne pense vraiment. »
Walt cite l’exemple significatif d’Elizabeth Warren, nouvelle élue sénatrice, demandant conseil à Lawrence Summers sur sa façon d’être efficace à Washington. Réponse de ce dernier : il faut choisir entre être insider ou outsider. Les seconds peuvent dire ce qu’ils pensent, mais les « gens de l’intérieur » ne les écoutent pas. Les insider peuvent mettre en avant et pousser leurs idées, ils sont écoutés par ceux qui comptent, mais ils comprendront alors la règle essentielle à leurs manœuvres : ils ne doivent jamais se critiquer entre eux. Un insider ne doit jamais critiquer un autre insider.
Walt peut lui-même être considéré comme un outsider. Il l’assume et a parfaitement conscience que ses valeurs trouvent, dans l’immédiat, un écho faible chez les faiseurs d’opinion. Le système est implacable et ne concerne pas que les États-Unis. On pourrait trouver les mêmes phénomènes dans les autres démocraties occidentales. Des sociétés ouvertes, démocratiques, respectueuses des droits individuels et collectifs, de ceux des minorités, mais qui ont une très forte tendance au conformisme intellectuel. Celui qui s’écarte de la ligne dominante n’est pas réveillé par la police à 5h du matin, mais il aura à faire à la police de la pensée, qui a des méthodes qui ne sont pas visiblement brutales, mais néanmoins efficaces pour tempérer l’envie de s’écarter du droit chemin idéologique. Il sera déclaré incompétent ayant la majorité des autres experts contre lui.
Pour Walt, la plupart des think tanks américains sont liés à des intérêts particuliers. Leur objectif n’est pas la recherche de la vérité ou l’accumulation de connaissances, mais plutôt le marketing politique d’idées soutenues par leurs sponsors. Ils font l’envie et l’admiration du reste du monde, par la qualité intellectuelle de ceux qui y officient, leur mobilité intellectuelle et les considérables moyens dont ils disposent. Mais ils sont formatés par le consensus du « Washington Belt ». Celui qui s’en écarte a peu de chance de conserver sa place ni de rebondir dans un autre think tank. Les think tanks, qui provoquent toujours l’envie et parfois l’admiration du monde entier, sont devenus, selon Walt, des organisations de plaidoyer déguisées en organes de recherche indépendants (p 100). Elles servent à donner des munitions intellectuelles dans une guerre politique partisane et sont sensibles aux intérêts des principaux donateurs.
Une fois leurs politiques mises en place et que leur caractère désastreux devient évident, les experts qui ont officié dans les administrations peuvent tranquillement retourner à d’autres activités. Les néoconservateurs n’ont en rien été discrédités par la catastrophe de la guerre d’Irak. Ils bénéficient des mêmes sinécures richement dotées à Washington et continuent de promouvoir la même version militarisée de l’hégémonie libérale, déplore Walt.
À l’inverse, la lucidité n’est pas toujours récompensée. En septembre 2002, rappelle Walt, 33 chercheurs en relations internationales mettaient en garde contre la guerre d’Irak, en déclarant qu’elle n’était pas dans l’intérêt des États-Unis. Aucun d’entre eux ne s’est vu proposer, depuis, un poste dans l’administration ou d’audition dans les groupes les plus prestigieux concernant la politique étrangère.
Quand un État est autant en sécurité que les États-Unis, convaincre ses citoyens de prendre l’habit d’un leader mondial n’est pas facile. La position géopolitique providentielle du pays ainsi que son histoire compliquent également cette démarche. Pour des raisons budgétaires les différentes agences gouvernementales ont un intérêt à plaider pour un plus grand interventionnisme américain. Le grand public défend donc moins l’ambition de croisade que le milieu de l’expertise.