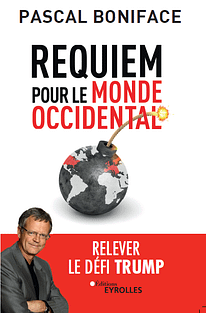13.12.2024
« Trump, syndic de faillite de l’hégémonie libérale ? » (2/5) – L’hégémonie libérale est morte, vive l’hégémonie illibérale !
Édito
18 janvier 2019

A l’occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d’articles d’analyse portant sur l’hégémonie libérale et la politique extérieure de Donald Trump.
La critique de l’hégémonie libérale par Trump est bienvenue mais les solutions alternatives qu’il propose sont aussi, voire encore plus, néfastes que cette hégémonie.
Trump pose les bonnes questions, mais apporte les mauvaises réponses.
La méthode tout d’abord, tans sur le retrait de Syrie annoncé que sur les autres décisions : aucune consultation avec aucun autre allié. Trump décide seul à partir d’un agenda qui lui est propre et sans tenir aucunement compte des effets collatéraux directs ou indirects sur la situation stratégique. Trump n’a pas non plus de réflexion globale sur les intérêts américains ni sur les conséquences régionales (qui pourtant ne peuvent pas n’avoir aucun effet en retour sur les États-Unis). Il s’agit plutôt d’une réaction épidermique de nature à satisfaire les soifs émotionnelles, apparemment prise sans réflexion globale.
Retrait de Syrie ? Pourquoi pas. Mais ne faut-il pas dans ce cas le programmer et ne pas le précipiter ? La décision sur l’Afghanistan est plus compréhensible. Depuis des années, l’État-major réclame sans cesse des effectifs supplémentaires pour un « dernier effort » dans ce qui est devenu la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis. Obama a été le premier à accepter le « surge », l’augmentation des troupes américaines après une forte réduction. Or, malgré les milliers de vies perdues, les centaines de milliards de dollars dépensées, en 2018, les Talibans sont toujours aux portes du pouvoir en Afghanistan et la présence militaire américaine toujours indispensable pour les empêcher de s’en emparer.
Mais plus encore, Trump veut en fait poursuivre, par d’autres moyens, la politique hégémonique libérale américaine. Il veut substituer une hégémonie illibérale à l’hégémonie libérale. Car la fin de l’hégémonie libérale ne débouche pas sur une politique multilatéraliste. Trump veut rationaliser l’impérialisme américain, en réduisant les coûts et maximisant les profits.
Personne ne peut avoir l’illusion d’une politique prenant en compte l’existence ou les intérêts des autres Nations. Pour Trump, les États-Unis doivent diriger le monde. Ils n’ont ni alliés ni amis, ils n’ont que des vassaux. Kim Jong-un est mieux traité qu’Angela Merkel parce que Trump a abandonné la politique des droits de l’homme pour satisfaire les besoins de sa propre diplomatie. Mais était-ce mieux avant ? Non. Les apparences étaient plus douces, mais les États-Unis ont toujours, dans leurs dénonciations des violations des droits de l’homme, fait prévaloir le niveau d’alliance sur la réalité du respect des droits de l’homme. La définition des États « voyous », dans les années 1990, censés ne pas respecter les règles de vie commune dans la société internationale, se concentrait sur les adversaires géopolitiques des États-Unis, pas sur le niveau de respect des droits humains.
Trump veut réduire la facture militaire et baser la domination stratégique américaine sur la menace de cette dernière (en tout dernier recours). Mais surtout, il veut profiter de ce qu’il reste encore de la suprématie économique américaine pour faire plier les autres pays, mettant dans un même panier ses alliés, ses rivaux. Il exacerbe les menaces des conséquences des lois extraterritoriales pour faire plier ceux qui naturellement n’auraient pas suivi la voie de Washington.
Le 13 janvier 2019, Trump a menacé de « détruire économiquement la Turquie », si celle-ci s’en prenait aux Kurdes syriens. Il ne s’embarrasse donc même pas d’une justification de non-respect d’une norme internationale. Il s’agit simplement du bon vouloir des États-Unis.
La gestion de l’accord nucléaire iranien est emblématique. Non seulement contre l’avis des cosignataires (alliés comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, ou rivaux comme la Russie et la Chine) et l’avis de la quasi-totalité des autres États (à l’exception d’Israël et de l’Arabie saoudite), Trump a rompu l’accord. Mais surtout, il a décidé de sanctionner les sociétés étrangères qui continueraient à commercer avec l’Iran. Quel que soit l’avis du gouvernement français, Total, Air France, Peugeot et d’autres se sont retirés du marché iranien. Parce qu’aussi prometteur que soit ce marché, il ne peut pas valoir le risque de se voir interdire l’accès au marché américain. Mais si Trump pousse à l’extrême la menace de l’extraterritorialité, il ne l’a pas inventée. C’est entre autres exemples sous Obama que la BNP Paribas (accusé d’avoir contourné l’embargo sur le Soudan et l’Iran) a été condamnée à 9 milliards de dollars d’amende par le département de la justice américaine. Et c’est sur la base de cette législation qu’Alstom est passé sous contrôle américain.
À partir d’une législation d’abord adoptée pour lutter contre la corruption (à la suite du scandale de l’affaire Lockheed dans les années 1970) d’abord à l’encontre des sociétés américaines, il y eut un glissement vers les entreprises étrangères pour des motifs de non-distorsion de la concurrence, on est parvenu à donner au département de la Justice américaine un pouvoir de niveau international. Les États-Unis refusent la justice internationale, à l’image de la CPI, mais ils veulent que leur justice nationale puisse s’exercer à l’échelle mondiale. Mais cet impérialisme économique n’est pas né avec Trump. L’affaire Alstom – General Electric ou le cas de la BNP Paribas sont là pour le prouver.